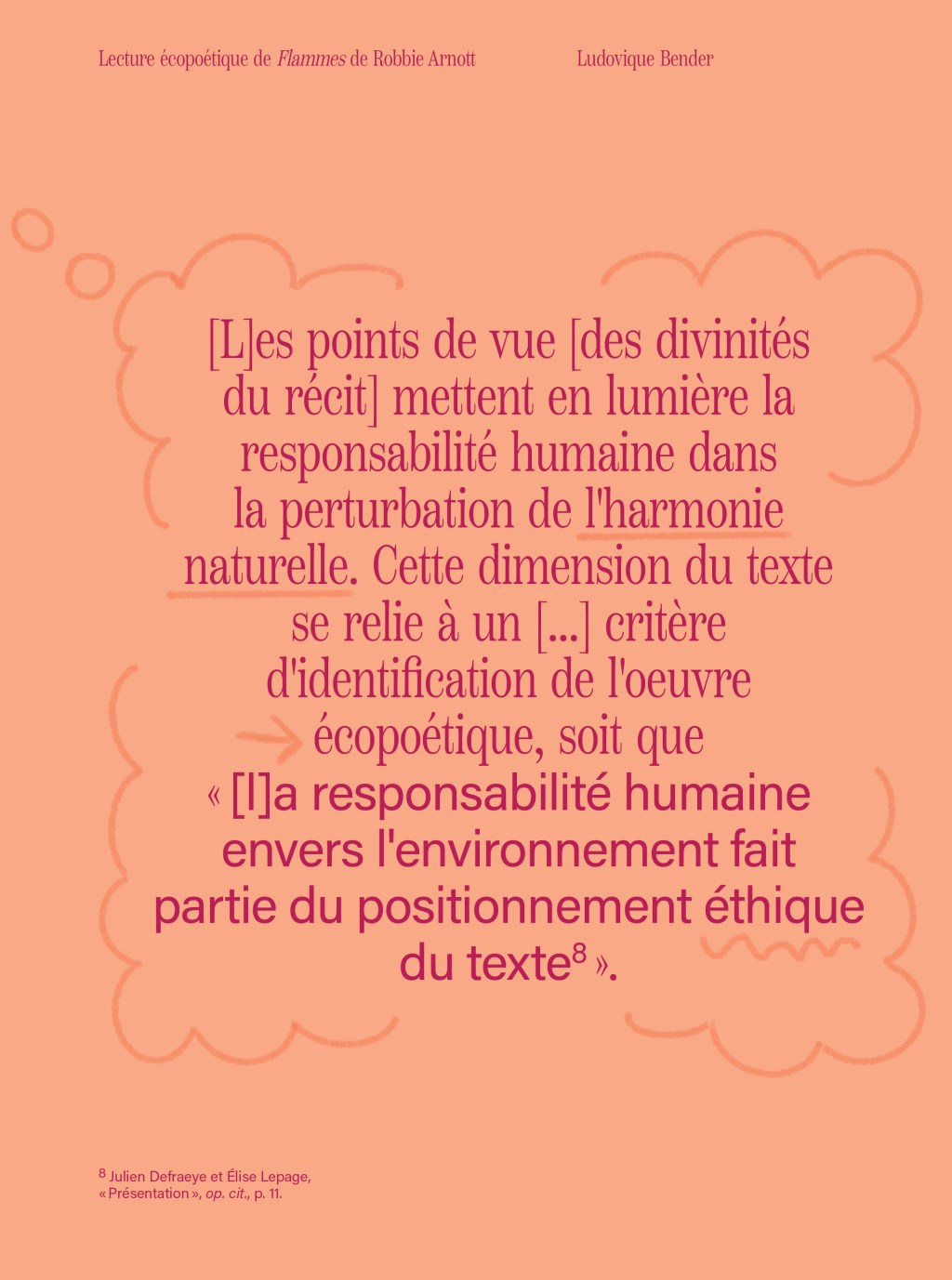Avec la parution en Australie de son premier roman Flammes en 2018, l’auteur tasmanien Robbie Arnott fait une entrée remarquée dans le champ littéraire. Son œuvre est en lice pour plusieurs prix littéraires, remporte le prix Margaret Scott en 2019 et est publiée en français la même année aux éditions Alto. Dans ce premier roman, Robbie Arnott propose un univers où le monde naturel, et plus particulièrement l’environnement de la Tasmanie, occupent une place de premier rang. L’auteur semble ainsi rejoindre une tendance qui marque de plus en plus d’écrivains de l’extrême contemporain, à savoir la considération, dans le littéraire, des enjeux écologiques, ainsi que de la nature pour elle-même et dans ses relations à l’humain1. L’émergence d’un tel corpus a par ailleurs façonné une nouvelle perspective en études littéraires : l’écopoétique. Selon les définitions théoriques proposées par Élise Lepage, Julien Defraeye et Pierre Schoentjes, cette perspective théorique a pour but « d’étudier la représentation littéraire des liens entre nature et culture, humain et non-humain2 » et de « cerner comment l’imaginaire contribue à façonner un nouveau rapport à la nature et à l’environnement, dans un monde où la prise de conscience écologique est devenue centrale.3 » L’approche écopoétique se veut centrée sur le fait littéraire, particulièrement les constructions du discours, de l’énonciation et de la narration en ce qu’elles façonnent un rapport à l’environnement4. En ce qui a trait à Flammes, ce roman repose d’une part sur le thème de l’interconnexion au monde naturel, et, d’autre part, s’appuie sur une forme narrative polyphonique originale et complexe. L’analyse proposée permettra donc de relever comment la forme narrative de Flammes met en relief les dimensions écopoétiques de l’œuvre. Après une description et un bref résumé de l’œuvre, on examinera la présence du point de vue non humain dans le texte, puis la composition d’une codépendance entre l’humain et la nature, le tout en s’appuyant sur divers aspects narratifs du roman.
Flammes est un roman divisé en quinze chapitres qui présentent tous, à une exception près, des situations narratives différentes. On y retrouve des narrations à la première personne et à la troisième personne, exploitant des points de vue divers. On y retrouve aussi des échanges de lettres, des extraits de journal intime ou encore des chapitres d’autobiographies fictives. Le tout présente une fresque de personnages et de récits qui couvrent des périodes variées d’une histoire qui semble d’abord éclatée entre tous ses segments, mais qui finit par converger. Le récit se déroule sur l’île de la Tasmanie et respecte des codes du réalisme magique, où le merveilleux s’imbrique naturellement à l’univers du réel.
Au noyau de l’histoire, on retrouve Levi et Charlotte McAllister, frère et sœur, alors que leur mère vient de mourir. Lorsqu’ils répandent ses cendres dans la nature, elle revient brièvement d’outre-tombe transformée par la faune et la flore du milieu où ses cendres ont atterri. On nous explique que cette forme de résurrection temporaire est un phénomène qui touche toutes les femmes McAllister depuis des générations. Après cet évènement, Levi est en état de choc et Charlotte vit difficilement son deuil. Mais Levi, qui méprend le deuil de Charlotte pour une peur de sa propre résurrection future, se met en tête de lui construire un cercueil pour lui éviter le même sort le jour de sa mort. Quand elle découvre le projet lugubre de son frère, Charlotte s’enfuit. On suit ensuite en parallèle leurs quêtes respectives : Charlotte tente d’échapper à sa situation familiale, tandis que Levi essaie de retrouver Charlotte et de finir son cercueil. À travers cette prémisse, le lecteur rencontre les points de vue de divers personnages et esprits naturels. La trame du récit étant complexe et non-linéaire, les éléments pertinents à la compréhension de l’analyse continueront d’être introduits au fur et à mesure.
La première chose à observer en vue de faire apparaître la dimension écopoétique de Flammes est la place accordée au point de vue non humain au sein de la narration. En effet, parmi les quatre critères d’identification d’une œuvre écopoétique décrits par Julien Defraeye et Élise Lepage, l’un d’eux est que « les intérêts humains ne sont pas présentés comme les seuls intérêts légitimes.5 » Dans Flammes, cela ne passe pas par un partage de la parole narrative, mais bien par un partage des points de vue, ou foyers de perception ; les focalisations, selon la catégorisation de Genette, y restent globalement internes, donc limitées à la conscience d’un « personnage » à la fois, malgré la transfocalisation entre les chapitres6. En d’autres termes, chaque chapitre est écrit à travers un point de vue différent. À plusieurs reprises, des chapitres, dont la narration est hétérodiégétique, adoptent comme personnage focal des esprits ou dieux du monde naturel, qui représentent chacun des facettes distinctes de l’environnement. Le premier exemple est le chapitre « Fer », narré du point de vue du dieu du fleuve Esk qui vit sous la forme d’un rat d’eau australien. La narration traduit sa perspective par un usage très appuyé du discours indirect libre et montre une conscience ancrée dans le monde naturel qui fait passer au premier plan les intérêts de la nature. Il remarque ainsi :
Les fruits du Dieu Gommier roulaient dans l’eau de toutes parts, les adeptes du Dieu Fourrure imprimaient dans le sol des rythmes qui se propageaient jusque dans la substance de l’eau, et les mues du Dieu Écorce tombaient de leurs troncs et flottaient à la surface de son fleuve. Et dans le moindre de ces détails, le Dieu Esk remarquait à quel point leur présence était diminuée ; à quel point, par le passé, tout ce qui concernait la terre et l’eau avait eu quelque chose de plus grand, de plus vaste ; à quel point ce goût de fer caractéristique du sang s’était infiltré dans tout ce qu’il voyait, sentait, et touchait.7
Comme la fin du passage commence à le montrer, on retrouve dans ce chapitre une perspective qui s’oppose franchement au monde humain. Effectivement, le Dieu Esk est enragé dès qu’il rencontre une manifestation de la présence des humains, qu’il appelle les singes. En plus de la colère, son point de vue est marqué par une forte assurance et un sentiment de toute puissance, comme on peut le voir quand il se retrouve en cage :
Son instinct lui dicta de mettre cette cage ridicule en miettes et de lacérer la chair tremblotante de son ravisseur, mais la suffisance de son sourire le retint. Non, songea-t-il. Il allait attendre que ce crétin ouvre la trappe et alors il bondirait, tourbillon de mort noir et or, et il sentirait ce sourire se transformer en agonie lorsque les muscles du singe fondraient sous ses crocs. (FLA, p. 56)
Ce qui est d’autant plus intéressant avec cette narration, c’est que le sentiment d’autorité associé à l’esprit du fleuve contraste brutalement avec le cours des évènements racontés. En effet, à la fin du chapitre, le dieu Esk est tué sans pouvoir se défendre par Thurston Hough, un artisan du bois qui aide le personnage de Levi dans son projet. Un propos se dégage donc déjà de ce parti pris de l’énonciation, qui met en parallèle la force et la puissance de la nature et de sa volonté avec sa fragilité face à l’action des humains. Si on continue d’explorer cet exemple, on se rend toutefois compte que lorsqu’il est tué par l’humain, l’esprit de l’Esk perd le foyer de perception de la narration (son chapitre se termine), mais ne perd pas son agentivité dans l’histoire pour autant. Comme on le comprend dans les lettres écrites plus tard par Hough, ce dernier se fait harceler puis tuer par les animaux du fleuve en guise de vengeance. (FLA, p. 79) De plus, le Dieu Esk réussit ensuite à contaminer les points de vue des personnages qui s’emparent de sa fourrure. C’est le cas de Levi dont la perspective, alors qu’il commençait à douter de son projet mortuaire, change du tout au tout au contact de la fourrure : « À présent que ses doigts à lui ébouriffent ses poils, que cette chaleur inhabituelle l’envahit jusqu’au sommet de son crâne, il se sent plus sûr de lui que jamais. » (FLA, p. 184) Dans ce cas, la focalisation reste sur Levi, mais le l’assurance du Dieu Esk, et éventuellement sa colère et son sentiment d’autorité, viennent s’y greffer.
Par ailleurs, la perspective du Dieu Esk est intimement liée à celle d’une autre entité naturelle, la Déesse Nuage, sur laquelle se focalise le chapitre « Nuage », vers la fin du roman. Dans cet univers, un lien très fort unit les deux esprits, qui ne cessent d’évoquer l’amour qu’ils se portent l’un l’autre. À travers le texte, ce couple non humain met en scène le lien qui unit le fleuve au nuage dans le cycle de l’eau, et, par le fait même, l’interconnexion et l’interdépendance entre les éléments naturels. Plus tard dans le roman, les humains provoquent le chagrin infini de la Déesse Nuage en assassinant le Dieu Esk, une tristesse qui se traduit par une tempête dévastatrice et des inondations partout en Tasmanie :
Elle n’alimenterait plus jamais son royaume avec ses larmes d’amour désolé. Elle ne le nourrirait plus de sa pluie. Plus jamais, jamais.
Une tristesse de nuage : vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est. Mais vous pouvez le sentir, dès qu’une tempête s’abat sur le monde avec une force inhabituelle. Quand les montagnes se fissurent et les forêts sont inondées. Quand les fleuves débordent et les océans enflent. Quand il ne reste nulle part au monde où s’abriter. Car les tempêtes les plus violentes naissent de la tristesse. (FLA, p. 246)
L’auteur s’inspirait d’ailleurs d’une réelle tempête qui avait eu lieu quelques années plus tôt. Dans l’univers de Flammes, les catastrophes climatiques sont donc à voir comme des conséquences des blessures portées par l’humain à la nature. Ultimement, les points de vue du Dieu Esk et de la Déesse Nuage dans le récit mettent en lumière la responsabilité humaine dans la perturbation de l’harmonie naturelle. Cette dimension du texte se relie à un autre critère d’identification de l’œuvre écopoétique, soit que « [l]a responsabilité humaine envers l’environnement fait partie du positionnement éthique du texte»8. La critique des actions humaines, dépeintes comme opposées aux intérêts non humains, se retrouve dans chaque occurrence de perspectives non humaines. C’est aussi le cas dans le chapitre « Charbon », qui adopte le point de vue du feu, et le chapitre « Plume », où l’esprit du cormoran s’immisce progressivement dans la conscience d’un homme. Toutes ces perspectives évoquent un réseau d’esprits de la nature bien plus vaste, vivant en totale indépendance des humains. L’histoire de l’esprit du feu le laisse entrevoir :
Il rencontra même des êtres similaires à lui – des êtres de roche, de sable, de terre et de glace, qui vivaient en gros de la même façon que lui, bien qu’ils ne fussent pas semblables à lui, enfin pas tout à fait. Certains arboraient pelage et plumage et veillaient sur les créatures auxquelles ils ressemblaient. D’autres flottaient haut dans le ciel et se déchargeaient de pluie pour l’éteindre quand ça leur chantait. D’autres nageaient dans les rivières et se proclamaient dieux. Certains étaient bons. D’autres, tel cet esprit oiseau assoiffé de sang qu’il rencontra aux confins du Sud-Ouest, étaient cruels. La plupart étaient calmes, s’échinant seulement à prendre soin des créatures ou de l’élément desquels ils se sentaient le plus proches. (FLA, p. 197)
À travers la perspective de l’esprit, on voit se déployer la grande diversité qui se côtoie dans le monde naturel. Tous ces exemples s’ajoutent entre eux et forment le reflet d’une conception animiste du territoire tasmanien au sein du roman, qui permet de se détourner en partie du point de vue anthropocentré et d’offrir une perspective qui traverse le temps et « s’inscrit dans l’histoire naturelle9 », un autre critère écopoétique.
D’un autre côté, la structure narrative globale du roman crée une logique de codépendance et d’harmonie nécessaire entre l’humain et la nature. D’abord, en mettant en parallèle les premiers et derniers chapitres du roman, on voit se dessiner un fil directeur dont l’enjeu central est le cycle de la vie qui recommence et qui unit tous les éléments naturels entre eux. Le premier chapitre commence par évoquer la mort de la mère des frère et sœur McAllister. En voici l’incipit :
Notre mère nous revint deux jours après la dispersion de ses cendres au-dessus des gorges de Notley Fern. Il s’agissait bel et bien d’elle – et en même temps, pas du tout. Depuis qu’on l’avait éparpillée parmi les frondes de Notley, elle avait changé. Sa peau était désormais recouverte de mousse moelleuse et verdoyante piquée de jeunes pousses d’hyménophylle. Six larges frondes de fougère arborescente avaient germé dans son dos et s’étiraient en dessous de sa taille en une queue de paon végétale. Et à la place de ses cheveux cascadaient des feuilles d’adiante vert gazon – peut-être la plus élégante de toutes les fougères. (FLA, p. 9)
L’image qui ouvre le roman repose sur une interconnexion inhérente au cycle de la vie dans l’idée que, à sa mort, le corps humain se fond dans l’écosystème et réengendre ainsi la vie. Le deuxième chapitre continue de poser l’imaginaire de la codépendance entre l’humain et le monde naturel en racontant l’histoire de Karl, le père de Nicola (une jeune fille que rencontrera Charlotte pendant sa fugue), ayant lié sa vie à celle d’une otarie qui, selon les mythes de l’île, était « la moitié qui [lui] faisait défaut depuis la naissance ». (FLA, p. 14) La mort de l’otarie vers la fin du chapitre laisse Karl en deuil profond. Les deux premiers chapitres sont ainsi marqués par la mort, et trouvent leur conclusion dans le tout dernier chapitre du roman. On retrouve aussi entre le premier et le dernier chapitre la seule répétition dans tout le roman d’une même forme narrative, soit la narration homodiégétique par le personnage de Levi. Avec ce soudain retour à la voix première, qui coïncide avec le dénouement et le retour des personnages au lieu de départ du récit, on comprend qu’une boucle narrative s’est formée au sein du texte et qu’un nouveau cycle peut recommencer. Ce sentiment est renforcé par le fait que, dans le premier chapitre, on constate chez Levi un rejet total du cycle de la vie dans son interconnexion au monde naturel. Il est horrifié par le sort de sa mère, qui attend aussi sa sœur. Il termine ainsi le premier chapitre : « Un processus sans fin, inquiétant, terrible même, et plus Charlotte luttait, plus je me tracassais ; alors je fis ce qui me semblait juste. Je me mis en quête d’un cercueil, et jurai de l’enterrer entière et morte. » (FLA, p. 12) C’est assez frappant : Levi désigne précisément le « processus sans fin » de la vie et de la mort comme quelque chose d’inquiétant et de terrible. Ici, les considérations narratologiques du théoricien de la littérature Yves Citton apparaissent intéressantes. Selon Citton, tout récit est « l’occasion de (se) poser (plus ou moins consciemment) un certain nombre de questions relevant de l’axiologie et de l’éthique […], les récits apparaissent comme des machines qui nous projettent dans des conflits de valeurs10 ». En se penchant sur la structure narrative d’un récit, il propose un axe d’analyse se concentrant sur le « destin que subissent les valeurs au fil du déroulement de l’histoire11 » ; les valeurs initiales du personnage pouvant soit être réaffirmées ou invalidées par le récit. Dans Flammes, on constate que le rapport à la nature de Levi est effectivement mis à l’épreuve, et que le récit met finalement en scène l’échec de ses valeurs premières. Dans le dernier chapitre, lorsqu’il reprend la parole, sa sensibilité a changé ; il est enfin en paix avec le monde qui l’entoure. Guidé par le père de Nicola, il va alors lui-même lier son âme à celle d’une otarie, poursuivant le cycle interrompu au deuxième chapitre. C’est ce que nous montre l’excipit :
Quelque chose a enflé en moi, d’énorme et d’irrépressible, depuis le creux de mon ventre jusqu’à ma nuque. Plus ça se déployait, plus je m’élevais, en haut de la vague. Et dans cet essor, je me suis tenu à l’otarie, j’ai gardé mon regard dans le sien, et j’ai attendu de retomber au creux de la vague. Mais là, dans tout ce sel, ce quelque chose a continué à enfler. Et depuis, il me garde à flot. (FLA, p. 257)
On a là une fin ouverte vers l’avenir, où les éléments humains et naturels sont enfin harmonisés. Ce travail du texte sous forme de cycle rejoint sa forme écopoétique, puisqu’on y retrouve l’idée d’« un environnement comme processus plutôt que constante ou acquis12 », soit le dernier critère décrit par Defraeye et Lepage.
Une autre manière d’inscrire le rapport d’interdépendance du monde humain et naturel dans la structure narrative est le partage alterné des chapitres à focalisations humaines et non-humaines, que nous avons déjà abordé en partie. En effet, il est intéressant de constater que, si les points de vue humains et non humains sont les uns comme les autres rapportés à plusieurs reprises par une voix narrative hétérodiégétique, ils n’ont jamais directement la parole en tant que narrateurs extradiégétiques assumés. Les seuls à pouvoir concilier une narration à la fois homodiégétique, donc au « je », et extradiégétique (ce qui exclut les narrations au « je » contenues dans les chapitres qui se présentent comme des extraits de journal et de livre fictif) sont Levi et Charlotte. Qu’est-ce qui les distingue de tous les autres acteurs du récit ? Leur unicité repose sur le fait que leur mère est humaine et que leur père se révèle être l’esprit du feu, une entité du monde naturel. Leur existence même est donc le symbole d’une réunification accomplie entre l’humain et la nature. On peut alors supposer que c’est cette harmonie retrouvée qui permet enfin aux personnages une prise de parole directe, libre et non problématique, au sens où elle n’est pas rapportée à travers le filtre du discours indirect libre ou d’un autre procédé intradiégétique (par exemple le journal intime ou le livre fictif). D’ailleurs, le chapitre « Bosquet », qui donne la parole à Charlotte, arrive seulement après que sa nature mi-humaine, mi-flammes se révèle au lecteur, comme si elle ne pouvait devenir narratrice qu’après avoir pleinement accepté sa nature en l’extériorisant. En effet, Charlotte fait comprendre dans sa narration que, jusqu’alors, elle refoulait ses flammes :
Parce que si les flammes ne se sont mises à s’écouler de moi qu’à Melaleuca, je les sentais déjà crépiter en moi à la maison. Chaque égratignure provoquait une étincelle, chaque respiration contenait de la fumée, chaque pas pieds nus roussissait le parquet. Levi ne voyait rien, mais moi, tout. Je brûlais depuis que notre mère avait pris feu. Les flammes ont peut-être toujours été là. (FLA, p. 220-221)
Libérer ses flammes permet en quelque sorte de libérer sa parole. C’est en ce sens que, encore une fois, Flammes met en scène l’acceptation de la liaison nécessaire entre la vie et la mort mais aussi entre l’humain et l’environnement.
Finalement, pour en revenir à la question du lien entre les dimensions écopoétiques de l’œuvre et sa forme narrative, on comprend à présent que cette forme permet et construit un propos. D’une part, inscrire différentes perspectives non humaines dans la narration permet de critiquer l’anthropocentrisme, de souligner l’importance du respect des écosystèmes et de rappeler le pouvoir de la nature. D’une autre part, toute la logique narrative du roman construit un rapport de codépendance entre les êtres humains et le reste de la nature, rapport qui s’inscrit dans un processus cyclique de renouvellement. En somme, toutes les fluctuations et les différentes parties interconnectées du roman font en sorte que l’œuvre se déploie elle-même comme un organisme vivant et complexe à l’intérieur du jeune écosystème de l’« éco-littérature ». Par ailleurs, rappelons que l’écopoétique se veut une branche spécifique de l’écocritique. Dans le cas de Flammes, au-delà de sa forme narrative, d’autres dimensions de l’œuvre pourraient être examinées en restant dans le champ de l’écocritique. Par exemple, des études sur d’autres œuvres ont fait valoir l’intersection intéressante entre le réalisme magique et le champ de l’écocritique et ont proposé de concevoir des codes et des méthodes d’analyse d’un « réalisme écomagique13». Pour ce qui est du champ de l’écopoétique, il nous semble également que la forme unique de Flammes permet d’ouvrir les horizons quant aux types de textes sur lesquels pourrait se pencher cette discipline. En effet, l’écopoétique s’est pour l’instant principalement penchée sur la fiction et le genre romanesque14, mais pourrait continuer à se construire en ouvrant davantage son corpus aux genres poétiques ou hybrides.
BIBLIOGRAPHIE
Arnott, Robbie, Flammes, Québec, Alto, coll. « Coda », 2021, 259 p.
Citton, Yves, « Fictions », Lire, interpréter, actualiser : pourquoi les études littéraires?, Paris, Amsterdam, 2007, p. 254-279.
Defraeye, Julien et Élise Lepage, « Présentation », Études littéraires, vol. 48, no 3, 2019, p. 7-18.
Genette, Gérard, Discours du récit, Paris, Seuil, coll. « Points », 2007, 435 p.
Pearson, Laura A., « Ecomagical Realism in Alexis Wright’s Carpentaria and Linda Hogan’s People of the Whale », dans Christopher Warnes et Kim Anderson Sasser (dir.), Magical Realism and Literature, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Critical Concepts », 2020, p. 300-318.
Schoentjes, Pierre, « L’écopoétique : quand ‘Terre’ résonne dans ‘littérature’ », L’Analisi linguistica e letteraria, vol. 24, no 2, décembre 2016, p. 81-88.
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », Études littéraires, vol. 48, no 3, 2019, p. 12. ; Pierre Schoentjes, « L’écopoétique : quand ‘Terre’ résonne dans ‘littérature’ », L’Analisi linguistica e letteraria, vol. 24, no 2, décembre 2016, p. 82. ↩︎
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », op. cit., p. 7. ↩︎
- Pierre Schoentjes, « L’écopoétique : quand ‘Terre’ résonne dans ‘littérature’ », op. cit., p. 87. ↩︎
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », op. cit., p. 7. ↩︎
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », op. cit., p. 10. ↩︎
- Gérard Genette, Discours du récit, Paris, Seuil, coll. « Points », 2007, p. 194-200, 340-342. ↩︎
- Robbie Arnott, Flammes, Québec, Alto, coll. « Coda », 2021, p. 54. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle FLA, suivi du folio. ↩︎
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », op. cit., p. 11. ↩︎
- Ibid., p. 10. ↩︎
- Yves Citton, « Fictions », Lire, interpréter, actualiser : pourquoi les études littéraires?, Paris, Amsterdam, 2007, p. 274 ↩︎
- Ibid., p. 276. ↩︎
- Julien Defraeye et Élise Lepage, « Présentation », op. cit., p. 10. ↩︎
- Laura A. Pearson, « Ecomagical Realism in Alexis Wright’s Carpentaria and Linda Hogan’s People of the Whale », dans Christopher Warnes et Kim Anderson Sasser (dir.), Magical Realism and Literature, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Critical Concepts », 2020, p. 301. Nous traduisons. ↩︎
- Pierre Schoentjes, « L’écopoétique : quand ‘Terre’ résonne dans ‘littérature’ », op. cit., p. 87. ↩︎