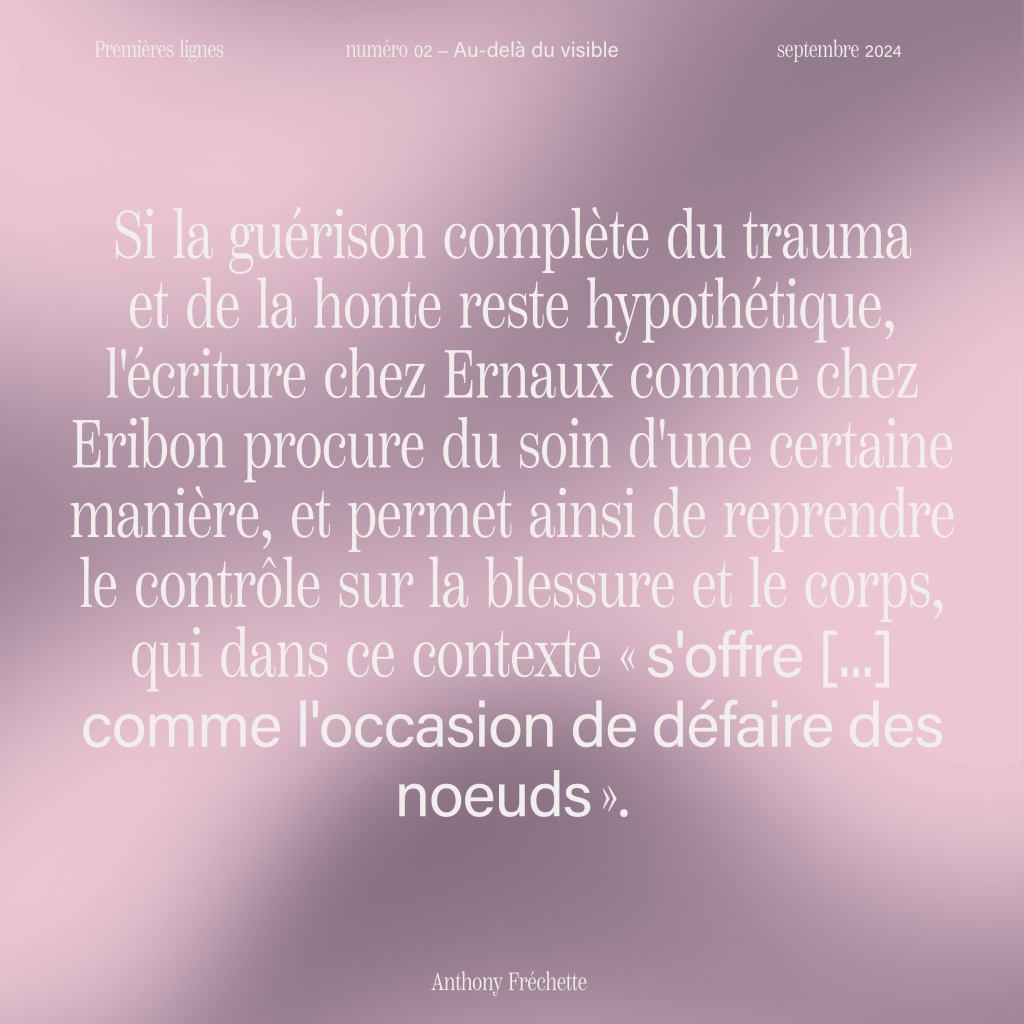« Dans la conception bourdienne, la honte est une “[…] émotion corporelle” », souligne Agnieszka Komorowska (2014, 45). Elle soulève également les propos du psychanalyste Léon Wurmser, qui affirme qu’elle est intimement liée au « refoulement » et au « reniement » ( 2014, 40). Cet affect est grandement présent dans l’œuvre de l’autrice Annie Ernaux, notamment dans La honte, bien sûr, mais aussi dans l’ouvrage Retour à Reims de l’écrivain et sociologue Didier Eribon, qui se dit « [u]n fils de la honte » (2018, 204). Chacun·e des auteur·rice·s, au sein de ces livres autosociobiographiques (Bon-Saliba 2020, 94) – et auto-analytique, comme nous le verrons avec Eribon (2018, 95), exprime d’abord un certain rejet lié à leurs origines, causé en partie par des traumas d’enfance. Cette part d’elleux-mêmes repoussée, traumatique et honteuse se manifeste physiquement chez les protagonistes, comme le montre le large lexique du corps employé dans leur narration. C’est en quelque sorte le surgissement de la honte dans sa dimension corporelle qui les incite à faire un retour, à se pencher sur celle-ci pour la disséquer et la comprendre. Nous proposerons que ce processus consiste donc en une forme de soin personnel, grandement motivé par le corps lui-même. La rédaction de ces œuvres s’inscrit ainsi directement dans une logique de réparation (Eribon 2018, 13), et ce, même si la guérison dans ces contextes n’est pas absolue (Parent 2006, 123). En somme, nous montrerons comment les démarches d’Ernaux et d’Eribon les rapprochent d’une « position de maîtrise » (116) face à leur passé honteux et traumatique.
Au cœur du livre La honte se trouve la scène, peu présente comme telle dans l’ouvrage, mais qui ne reste jamais bien loin, dans la mesure où c’est elle qui motive la rédaction tout au long du récit. On comprend rapidement que cet après-midi de juin où « [s]on père a voulu tuer [s]a mère » (Ernaux 1997, 13) consiste en un véritable trauma pour l’autrice, ainsi que son « entrée dans la honte » (116). Cet événement, et tout le contexte social qui l’entoure, soit la vie ouvrière, sont maintenant drapés de cet affect, donc repoussés par la narratrice. La rédaction même du livre n’y échappe pas; Ernaux dût prendre une pause de quatre mois avant de pouvoir poursuivre l’écriture du manuscrit (Havercroft 2005, 122). Bien que plusieurs de ses livres précédents abordent cette même période de son enfance, jamais ce trauma ne fut nommé (Willging 2001, 83) : « [j]’écris cette scène pour la première fois » (Ernaux 1997, 16), affirme-t-elle. Elle précise également qu’« il n’y avait de place pour la scène du dimanche de juin », que « [c]ela ne pouvait se dire à personne » (115), qu’elle était « la terreur sans mots » (21). Pour renforcer son rejet de l’événement, ainsi que le bagage émotionnel y étant associé, l’autrice affirme qu’il « a totalement été refoulé par la famille » (92). De manière plus générale, l’environnement dans lequel Ernaux évolue à cette époque ne favorise pas le traitement des émotions. Elle écrit qu’« [i]l n’y avait presque pas de mots pour exprimer les sentiments » (74). L’objectif est d’« [ê]tre comme tout le monde » (70), c’est-à-dire de respecter un code précis du comportement : « être simple, franc et poli », ne pas « rechercher la solitude » (68), sans non plus « “être toujours pendu” chez tel ou telle » (69), etc. Est donc encouragé de maintenir certaines apparences et de cacher le reste. Dans ces circonstances, la narratrice se voit dans l’obligation de repousser l’après-midi de juin en question, n’ayant aucun moyen pour le comprendre, ni personne vers qui se tourner. S’en suivent une gêne et un dégoût de son propre corps, maintenant taché par l’événement. Elle « ne ressembl[e] plus aux autres filles de la classe » (116) désormais, et invente même « le jeu de la journée idéale » (135), où elle réimagine chacune des parties de son corps en s’inspirant du contenu d’un magazine de mode. Cette relégation à l’imaginaire est présente dans une panoplie de passages qui expriment une impression d’absence du corps cet été-là : « [J]e n’étais dans rien » (18), « Impression qu’il n’y a pas de corps sous cet habit » (23-24), « [J]e ne croirais pas qu’il s’agisse de moi » (26), ou bien « Je n’étais nulle part encore au milieu des corps » (127). Alievtina Hervy propose que cette perception de l’écrivaine exprime « une tentative d’évasion » face au honteux, un désir « d’abandonner [son] corps au passé » (2017, 449). Nous y voyons aussi tout simplement le sentiment que lui inspire cette période de sa vie, soit celui d’une subjectivité toujours en formation, parmi ces « langages qui [la] constituaient » (Ernaux 1997, 40) autrefois et par lesquels elle tente de se définir. La toute fin de l’ouvrage fait d’ailleurs référence à un « orgasme où [elle] ressen[t] le plus [s]on identité et la permanence de [s]on être » (142), donc une sorte d’aboutissement identitaire, sans toutefois en révéler davantage, si ce n’est que l’événement en question se déroule deux années après. Parallèlement à l’absence du corps se trouve la souffrance, celle d’une multitude de maux dont est victime la narratrice dans les mois qui suivent le trauma, dont un doigt qui s’infecte, une dent cariée, ainsi qu’un « mal étrange », de nature psychologique selon elle, où ce qu’elle regarde paraît « défiler constamment » (128). Elle est aussi aux prises avec un rhume qui dura tout le mois de juillet, accompagné d’une oreille bouchée, situation qui lui fait croire qu’elle est « condamnée à vivre ainsi » (120). Cet état rappelle évidemment sa position sans issue face à la honte et illustre bien le mal-être qui habitait l’autrice à cette époque, à même le corps.
Le repli sur soi-même qu’exprime ici Ernaux est bien présent chez Eribon qui lui aussi écrit le rejet et la honte dans son ouvrage Retour à Reims. De son côté, c’est surtout la figure du père qui est repoussée, et avec elle le monde ouvrier, dont l’auteur est également issu. C’est seulement lorsque son paternel, atteint de la maladie d’Alzheimer, est placé en clinique qu’Eribon peut enfin rétablir les liens avec sa mère. Il écrit de son père qu’il « incarnait tout ce qu[‘il] avai[t] voulu quitter » (2018, 17), qu’il était « stupide et violent » et lui « avait inspiré tant de mépris » (31). Il prend toutefois soin de spécifier : « La clé de son être : où et quand il est né » (35), rappelant que derrière l’individu se trouve un contexte, dans ce cas-ci la pauvreté extrême, celle de la classe ouvrière, accentuée par la Deuxième Guerre mondiale qui fut source d’une grande terreur. Le père figurait d’ailleurs sur la photographie d’origine utilisée pour la couverture du livre, avant qu’Eribon le coupe littéralement du portrait (Bon-Saliba 2020, 93), montrant la rupture qu’il souhaitait conserver. Quoique d’une manière plus subtile que le récit d’Ernaux, celui du sociologue porte aussi le trauma, issu d’« épisodes » qui « n’étaient pas rares » (Eribon 2018, 99) : ceux du père « rentrant ivre mort après une disparition de deux ou trois jours » et lançant des « bouteilles – huile, lait, vin » (96) contre un mur de la maison. Rien pour garder la figure paternelle hors du refoulé chez l’auteur, qui affirme : « Le lancer de bouteilles […] inscrivit en moi […] un dégoût de cette misère, un refus du destin auquel j’étais assigné et la blessure secrète, […] d’avoir à porter en moi, à jamais, ce souvenir » (99). Eribon renverse également son rejet en identifiant comment son milieu l’a d’abord repoussé lui-même : « [J]e pourrais aussi bien renverser la phrase et dire que c’est ma famille qui s’était dressée contre tout ce à quoi j’adhérais, […] tout ce que j’étais et représentais à leurs yeux » (117). Il déclare d’ailleurs Reims comme étant « la ville de l’insulte » (201), renvoyant entres autres aux injures homophobes qu’il recevait en permanence. Cette mise à distance qu’a dû effectuer l’auteur, littéralement rejeté par son environnement, était donc la seule option, de la même manière qu’Ernaux n’avait aucune autre solution que de repousser l’après-midi de juin, n’ayant aucune ressource dans son entourage. Eribon ajoute : « Du jour où je la rencontrai, l’insulte ne cessa plus de m’accompagner » (201), rappelant grandement l’« entrée dans la honte » (Ernaux 1997, 116) de l’autrice, sans possibilité de retour, et ses mots à propos d’une photo d’enfance : « [I]naugurant le temps où je ne cesserai plus d’avoir honte » (Ernaux 1997, 26). Le sociologue établit un lien direct entre l’injure et cet affect : « [V]ocables hideux dont la simple évocation aujourd’hui ravive en moi le souvenir, jamais disparu, […] du sentiment de honte qu’ils gravaient en mon esprit » (Eribon 2018, 204). On voit ici comment la blessure perdure dans le temps, à jamais, comme les signifiants entourant le trauma chez Ernaux – religieux, familiaux – « exercent encore […] leur pesanteur » (Ernaux 1997, 40).
Cette honte, provenant de son milieu d’origine, habite le corps même d’Eribon, comme c’est le cas pour l’écrivaine. Il décrit par exemple une scène où il croise par hasard son grand-père, « laveur de carreaux », à Paris, et la sensation physique découlant de cette rencontre : « J’étais déchiré. Mal dans ma peau » (Eribon 2018, 72). Cette réaction est causée par une double honte, celle de ses origines, mais également celle d’être gêné par elles. Eribon reconnaît en effet cet « écartèlement entre les deux personnes qu[‘il] étai[t] » (72), c’est-à-dire entre l’étudiant et le fils de famille ouvrière, qui lui cause un « malaise » (14). De là provient toutes sortes de manifestations impliquant le corps, par exemple « une gêne, voire de la haine » (26) face aux commentaires méprisants envers sa classe sociale d’origine, ou quand lui-même formule de tels préjugés. Il ne peut toutefois retourner dans son milieu d’enfance, référant ici aux mariages de ses frères : « [L]’impossibilité pour moi de me retrouver immergé dans ces formes de sociabilité et de culture qui m’auraient mis horriblement mal à l’aise » (106). Eribon prend d’ailleurs le soin de reconnaître l’écriture du retour d’Ernaux : « Elle y évoque à merveille ce malaise que l’on ressent lorsqu’on revientchez ses parents après avoir quitté non seulement le domicile familial mais aussi la famille et le monde auxquels, malgré tout, on continue d’appartenir » (28).
On remarque donc que dans leur livre respectif, les auteur·rice·s écrivent le rejet, ce qu’iels repoussent, mais aussi les manifestations corporelles qui en résultent et qui refont surface. Chez Ernaux : « La honte est devenue un mode de vie pour moi. À la limite je ne la percevais même plus, elle était dans le corps même » (1997, 140), puis chez Eribon : « On éprouve donc dans sa chair l’appartenance de classe lorsqu’on est enfant d’ouvrier » (2018, 100). On constate également que le trauma s’inscrit dans chacun des récits (Thumerel 2011, 80), ce qui pourrait expliquer en partie l’importance des sensations dans leur écriture (Willging 2001, 88). Dans les mots de Jennifer Willging, qui fait ce lien entre le trauma et les « sensory memories » de La honte : « What the traumatized individual remembers […] are images, textures, smells, sounds, and emotions; that is, bodily sensations » (2001, 88). Un autre point commun dans la démarche des auteur·rice·s est le mouvement de retour qu’iels feront vis-à-vis la part rejetée d’elleux-mêmes et qui consistera donc en une forme de soin : « [P]our “sortir” du trauma, il faut y plonger » (Parent 2006, 117).
Andrea Oberhuber écrit dans son article Dans le corps du texte : « [L]e corps signale à tout moment la “peaurosité” des frontières : entre le dedans et le dehors, le pur et l’impur, le physique et le psychique, le rationnel et le sensible, le visible et le secret » (2013, 10), illustrant bien les mouvements que porte le corps, mais aussi son unité, ce dedans qui interagit avec le dehors. Quand Ernaux parle de l’écriture avec le corps, opposée à celle pour la forme, ou intellectuelle (Gesbert 2021), elle indique cette action de passation, cette peaurosité permise par les mots. Ainsi, La honte s’inscrit en plein dans ce mouvement de retour corporel, en ce qu’il traite du souvenir indicible pour l’autrice, qu’elle porte en elle depuis si longtemps. Après quelques tentatives de le raconter à des hommes qu’elle fréquente, plus précisément ceux qu’elle « avait dans la peau », elle comprend, vu leur silence, qu’elle commet « une faute » (Ernaux 1997, 16). Comme si la confession est trop grande pour être reçue, pour tenir en un aveu, qu’elle doit la déplier, un détail à la fois, la vider de son contenu. C’est donc réellement par l’écriture, ainsi pour une audience beaucoup plus large, qu’Ernaux accomplit son retour.
Du côté d’Eribon, cela commence avant Retour à Reims, par une « réconciliation » (Eribon 2018, 13) avec sa mère, et ainsi avec lui-même. Il écrit : « Ce à quoi l’on a été arraché ou ce à quoi l’on a voulu s’arracher continue d’être partie intégrante de ce que l’on est » (14), et que cette réconciliation concerne cette « part de [lui]-même […] refusée, rejetée, reniée » (13). Ainsi, la gêne qu’il porte depuis longtemps envers ses origines l’amène à cette réparation maintenant que le père, représentant une grande part de ce rejet, est hors du portrait. Eribon exprime même du regret d’avoir manqué une possible rencontre entre eux, « d’avoir, en fait, laissé la violence du monde social l’emporter sur [lui], comme elle l’avait emporté sur [son père] » (247). Comme l’écrit Fabrice Thumerel, le sociologue « vise à mettre fin à son exil » (2011, 78), cet « écartèlement » qui fait « violence » (Eribon 2018, 171), en revenant vers ses origines.
Dans les mots de Daphné B., tirés de Maquillée et cités en introduction de Self-care,dirigé par Nicholas Dawson : « Le selfcare exige un mouvement, non pas de repli sur soi, mais bien de retour vers soi » (Dawson 2021, 5). Ces entreprises des auteur·rice·s consistent en ce sens en une forme de soin envers elleux-mêmes. Pour Ernaux, cela s’effectue par « l’emploi du langage et de la narration » « pour confronter le trauma et la honte » (Havercroft 2005, 122). L’écriture de la scène la rend « grisée, incohérente et muette », alors qu’elle était « en “clair”, avec des couleurs, des formes distinctes » (Ernaux 1997, 31) avant la rédaction. Elle est d’ailleurs la toute première chose qui figure dans le livre, comme pour l’exorciser dès le départ et s’en débarrasser. On pourrait dire de même dans Retour à Reims, au sens où même si le trauma est raconté un peu plus loin dans l’ouvrage, Eribon aborde ce qui consiste en son rejet dès les premières pages : ses origines, sa famille, et plus particulièrement son père. Le soin de son côté s’effectue évidemment par les retrouvailles avec sa mère, mais aussi par « l’autosociothérapie » présente dans le livre, qui consiste à « approfondir une connaissance sociale de soi[,] […] mieux comprendre sa souffrance sociale et […] travailler à une certaine acceptation de soi », tout en permettant de « réfracter la violence subie vers la société des dominants » (Thumerel 2011, 80). En effet, Eribon ne manque pas de suivre le filon de son oppression vers sa source, comme dans le cas de son père, qu’il réussit à replacer dans un contexte social de guerre et de pauvreté ouvrière. Conjointement, l’ouvrage porte aussi l’« auto-analyse », concept « défend[u] par Pierre Bourdieu[,] qui se distingue de l’autobiographie […] par les éléments personnels retenus », soit ceux « nécessaires à l’explication et à la compréhension sociologique […] seulement » (Bon-Saliba 2020, 95).
L’écriture leur permet donc de s’approprier, ou plutôt de se réapproprier leurs corps qui furent « abandonn[és] […] au passé » (Hervy 2017, 449), en les acceptant et en les entretenant. Les mots du missel d’enfance d’Ernaux illustrent bien comment cela s’effectue pour elle : « [P]renez et lisez car ceci est mon corps et mon sang qui sera versé pour vous » (Ernaux 1997, 41), qu’elle cite pour renvoyer à son propre livre, dans un de ces moments autoréférentiels typiquement ernaliens. Cette image ajoute encore une autre dimension à l’écriture corporelle de l’autrice, renvoyant au livre comme objet physique, et faisant office de son corps. Eribon nécessite quant à lui ce filtre que constituent « les références culturelles : littéraires, théoriques, politique » (Eribon 2018, 246) vis-à-vis de son objet. Plus qu’« aid[er] à penser et à formuler ce que l’on cherche à exprimer », « elles permettent de neutraliser la charge émotionnelle qui serait sans doute trop forte s’il fallait affronter le “réel” sans cet écran » (246).Il ajoute d’ailleurs en entrevue : « [L]a force transformatrice de la théorie est potentiellement plus grande que celle de la littérature » (Bon-Saliba 2020, 94).
Tout de même, si la guérison complète du trauma et de la honte reste hypothétique (Parent 2006, 123), l’écriture chez Ernaux comme chez Eribon procure du soin d’une certaine manière, et permet ainsi de reprendre le contrôle sur la blessure et le corps, qui dans ce contexte « s’offre […] comme l’occasion de défaire des nœuds » (Oberhuber 2013, 14). Il s’agit ici d’une écriture de soi contribuant à la « cultivation plutôt qu’à la renonciation de sa personne », comme le théorisait Michel Foucault quant à ce type d’écrit chez les civilisations gréco-romaines (Galea 2014, 146).C’est bien en rédigeant cette renonciation, soit la scène chez Ernaux, le père chez Eribon, et plus globalement leurs origines familiales, qu’iels parviennent à l’« intégrer à l[eur] récit de vie » (Willging 2001, 101) et ainsi à accepter leur corps comme unifié. Dans leur ouvrage respectif d’autosociobiographie et d’auto-analyse, il est « un corps particulier qui appartient à un ensemble social plus large à l’intérieur duquel il agit » (Oberhuber 2013, 16), et bien sûr au sein duquel l’ensemble agit sur lui. En passant par le rejet et les symptômes, jusqu’au retour et à l’acceptation, iels nous rappellent finalement cette autre logique foucaldienne, issue du corps utopique (Hervy 2017, 449) : « [M]on corps est le complice inconditionnel de toutes mes évasions » (451).
Bibliographie
Bacholle-Bošković, Michèle. 2003. « Confession d’une femme pudique : Annie Ernaux ». French forum, vol. 28, n° 1 : 91-109.
Bon-Saliba, Brigitte. 2020. « Écrire pour transformer la honte ». Tiers, vol. 27, n° 1 : 93.
Dawson, Nicholas (dir.). 2021. Self-care. Montréal: Hamac.
Eribon, Didier. 2018 [2009]. Retour à Reims. Paris : Flammarion. coll. « Champs essais ».
Ernaux, Annie. 1997. La honte. Paris : Gallimard, coll. « Folio ».
Galea, Simone. 2014. « CHAPTER NINE: Self-Writing, the Feminine, and the Educational Constitution of the Self ». Counterpoints, vol. 462: 139-153.
Gesbert, Oliviaé. 22 novembre 2021. « Transfuges de classe : à l’origine était… Annie Ernaux », [enregistrement sonore]. Paris : Radio France. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/transfuges-de-classe-a-l-origine-etait-annie-ernaux-4751566?fbclid=IwAR3pBP7fTVTsEhajWdnAcnRiFJq44G3-Ygahnlvaj0LUHGJQauhP-CYDfe4. Consulté le 9 mai 2023.
Havercroft, Barbara. 2005. « Dire l’indicible : trauma et honte chez Annie Ernaux ». Roman 20-50, vol. 40, n° 2 : 119-132.
Hervy, Alievtina. 2017. « Le corps de la honte ». Bulletin d’analyse phénoménologique, vol. 13, n° 1 : 433-457.
Komorowska, Agnieszka. 2014. « La face cachée de la honte. Réflexions sur la théâtralité d’une émotion ». Nouvelle revue d’esthétique, vol. 14, n° 2 : 39-46.
Oberhuber, Andrea. 2013. « Dans le corps du texte ». Tangence, n° 103 : 5-19.
Parent, Anne Martine. 2006. « Trauma, témoignage et récit. La déroute du sens ». Protée, vol. 34, n° 2-3 : 113-125.
Rosso, Karine. 24 mai 2023. Annie Ernaux : Une femme en héritage, cours dispensé à l’Université du Québec à Montréal.
Thumerel, Fabrice. 2011. « Retour à/retour sur… Sociogénèse d’un paradigme heuristique : “Retour à Reims” de Didier Éribon ». Tumultes, n° 36 : 77-90.
Willging, Jennifer. 2001. « Annie Ernaux’s Shameful Narration ». French Forum, vol. 26, n° 1 : 83-103.