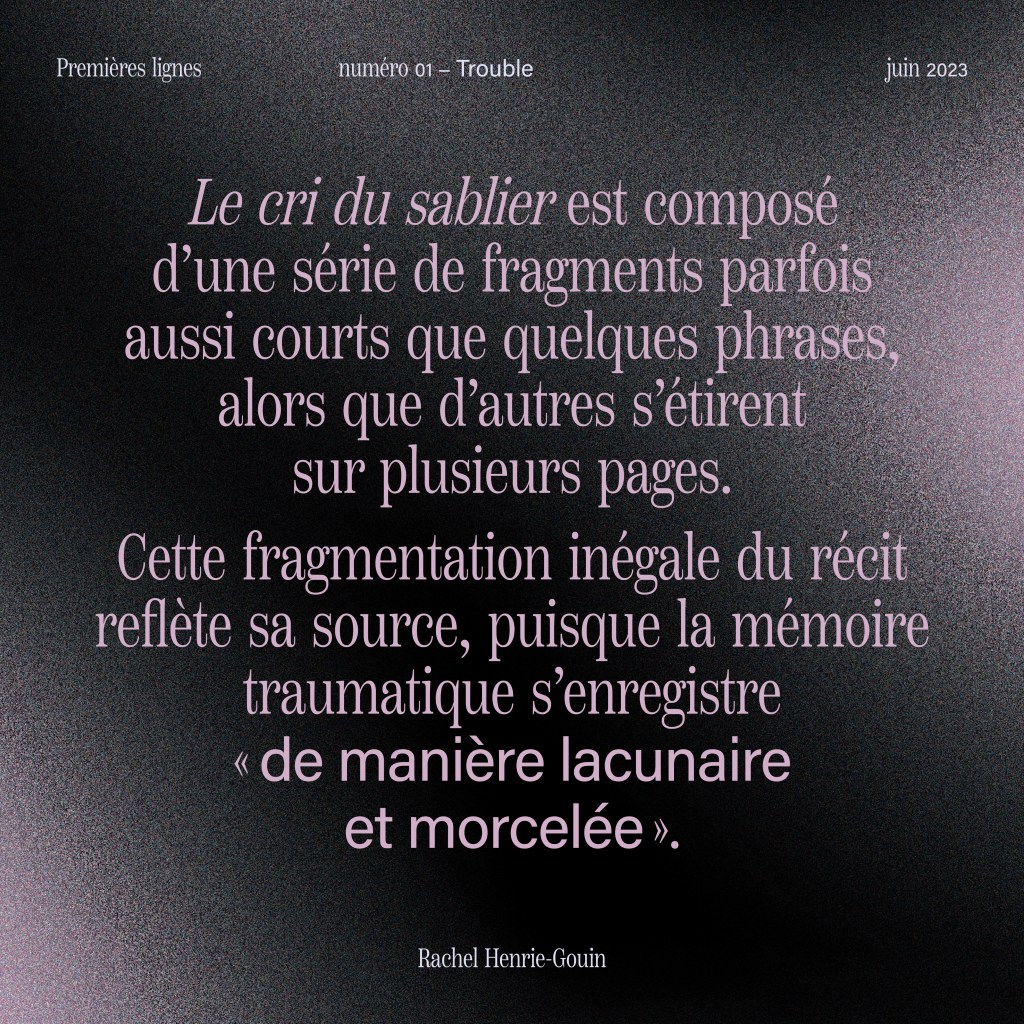« Maman se meurt première personne. […] Papa l’a tuée deuxième personne. Infinitif et radical. Chloé se fait troisième personne. Elle ne parlera plus qu’au futur antérieur. Car quand s’exécuta enfin le parricide il fut trop imparfait pour ne pas la marquer. »
Chloé Delaume, Le cri du sablier
La violence, lorsqu’elle est posée en tant qu’acte par un individu contre un autre, vise à la destruction partielle ou totale de ce dernier. Dans l’après-coup, le sujet ébranlé doit alors composer avec ce vécu morcelé. La littérature du trauma montre que ses conséquences, loin d’être stériles, peuvent mener à la production d’un récit qui permet de raconter les nuances d’un traumatisme. Bertrand Gervais, dans son analyse de l’oubli et de la violence, remarque que dans plusieurs œuvres l’oubli chez l’agresseur peut prendre une forme positive, celle d’un « processus de fuite[1] », permettant de préserver sa conscience coupable. Selon lui, la violence « n’est pas simplement la force brute d’un coup sur un membre, mais sa signification pour un sujet qui l’interprète[2] »; elle est une source de sens pour qui la perpétue, mais également pour qui la subi. Dans certains cas, la mémoire, qu’elle soit limpide ou lacunaire, peut s’imposer aux victimes, comme c’est le cas dans Le cri du sablier. Ce récit autofictionnel[3] de Chloé Delaume relate un climat de violence physique et psychologique causé par le père[4] de la narratrice et atteignant son paroxysme lorsqu’il tue sa femme et se suicide devant leur fille alors âgée de dix ans. Le roman raconte la vie de la survivante.Le monstre est mort, mais s’impose toujours à elle à travers une mémoire traumatique. Celle-ci se distingue d’une mémoire « non-traumatique », puisqu’elle s’ancre spécifiquement autour de l’axe de la violence. Comme le fait remarquer Marie-Pier Lafontaine, elle s’éloigne d’une « logique narrative classique, avec un début, un milieu et une fin[5] ». Ainsi, le texte de Delaume convoque l’oubli en y demeurant cependant à distance, puisque, contrairement à « l’être violent [qui] se consume tout entier dans son action qui ne laisse aucune place au langage et à la mémoire[6] », la narratrice delaumienne cherche à contrer l’oubli en imposant sa parole de victime marquée par le traumatisme. Le présent article traitera de la mise en récit de la mémoire traumatique et des différents procédés par lesquels la narratrice parvient à s’approprier et subvertir cette histoire qui la compose en cultivant une ambiguïté profonde et constitutive d’un récit issu d’un trauma. L’accès impossible à l’oubli est le premier aspect par lequel le caractère complexe et ambigu du roman de Delaume sera analysé, suivi de la tentative de la narratrice de dépasser l’injonction à l’oubli que ses proches lui imposent par l’acte d’une mise en récit en propre. Finalement, il sera question des différents procédés textuels par lequel la narratrice transforme et subvertit cette mémoire traumatique, comment elle compromet l’oubli pour transformer et mettre au monde son récit.
Quand la violence convoque la parole et le récit
L’interprétation du monde de la narratrice est affectée par la violence depuis l’enfance. Elle a grandi dans une maison où la loi du père est imposée par les coups et les menaces, forgeant ainsiles contours de sa mémoire : « Le père aimait remplir. Il tapissait muqueuses gorge et âme de peur rance. […] Il remplissait parois sachant que ce corps neuf ne pouvait déborder. Un corps neuf si trop vide. Lui donner des souvenirs [7] ». La réalité familiale brutale d’avant le drame constituait une situation de violence affectant déjà la mémoire de l’enfant, alors que le meurtre de la mère et le suicide du père composent l’événement reconstruit dans le texte. Le récit s’ouvre sur cette culmination meurtrière de la violence paternelle, marquant le trauma, ce coup à partir duquel se déclenche la mémoire traumatique. Le mot « trauma » signifie d’abord un « facteur extérieur agressif, brutal et perçant [qui] pénètre à travers l’enveloppe corporelle et [qui] provoque des dégâts tant sur celle-ci que sur les organes internes[8]. » Bien que la mémoire traumatique dans l’œuvre de Delaume soit issue d’une violence à la fois physique et psychologique, c’est l’assassinat qui déclenche le récit. Il s’impose dans les profondeurs de la mémoire traumatique qu’énonce la narration, qui devient la seule manière pour l’enfant de considérer l’événement : « Le traumatisme se déclenche […] dans l’après-coup de l’épisode. Il en est sa réponse symptomatique, une interprétation[9] ». La scène est gravée dans ses souvenirs et pousse immédiatement la narratrice dans un mutisme qui dure plusieurs mois. Le silence joue alors un rôle fondateur dans la tension entre la mémoire et l’oubli puisqu’il est constitutif de l’ambiguïté du rapport au réel. Cette relation trouble au réel est encouragée par l’ambiguïté autofictionnelle du texte, mais également par l’incertitude que le silence laisse planer, à savoir si le crime peut persister dans les archives mémorielles ou si le drame va tomber dans l’oubli : « Le témoin à charge portait en elle le poids des non-dits familiaux [et] des silences taboutés [sic][10] ». Ainsi, le silence, lié intrinsèquement à l’oubli, est encouragé par la famille élargie : « Si la petite reparle pour dire ce qu’elle a vu il y a des chances ma chère qu’elle nous relate le drame. […] Mieux vaudrait qu’elle se taise[11] ». Alors que le tabou mène à une forme de fuite, l’enfant tente de saisir l’étendue de ce qui est appelé le « drame ». L’interprétation de l’événement signifie, pour la fillette silencieuse, de confronter et de comprendre cette violence exacerbée par ses proches et par le support professionnel, qui cherchent à lui faire oublier l’évènement, ou du moins à le relater de manière inexacte. « Ils disaient l’accident [au lieu d’assassinat] et c’est aussi pour cela que je les ai haïs[12] ». Sa mémoire traumatique est renforcée par le fait qu’elle doive rectifier l’emploi d’un terme banalisant par l’autorité familiale. Le langage est l’un des principaux modes de contact avec le monde, et le fait qu’il soit temporairement problématique chez la narratrice – notamment en lui étant inaccessible –affiche une double violence : Kostas Nassikas explique que, pour une personne, être coupé de l’usage de la parole ou voir son langage détruit peut représenter une « destruction de l’humain, dans la mesure où ce qui caractérise principalement celui-ci c’est le lien que ces témoignages de sens ont avec la parole[13] ». La caractérisation du sujet est compromise à la suite de cet excès de violence, ce qui a pour effet d’accentuer l’importance de la prise de parole dans la mise en récit. L’enfant se tait, mais ce n’est pas pour s’effacer du monde; le silence du personnage de Delaume n’est pas synonyme d’un oubli passif. Au contraire, il représente le temps que l’enfant a pris pour comprendre et interpréter ce à quoi elle a assisté. La mémoire de l’expérience traumatique se concrétise alors qu’elle récupère la parole, neuf mois plus tard : « Il m’avait fallu voir pour devenir humaine. […] Neuf mois pour accoucher de l’humain qui germa au creux de la fillette à la robe souillée par la révélation. Neuf mois pour que la scène se digère en mémoire[14] ». Le silence issu de la destruction est (auto)créateur. Le traumatisme devient l’élément clef autour duquel reconstruire son rapport au monde, à même les débris. La prise de parole, issue du silence, est un acte de mémoire et, par conséquent, supplante l’oubli. La métaphore de la grossesse suppose que la narratrice a pu se (re)donner naissance et ce, à la suite de la perte de sa mère, représentée comme une double figure : celle de la victime, mais aussi celle du bourreau.
Reconstruire le récit : l’avènement de l’écriture
Si au moment de l’événement, la mère subit la fureur du père et meurt devant la fillette, la situation de violence qui régnait dans la maison familiale était néanmoins encouragée par la figure maternelle, faisant d’elle une participante, que ce soit par son silence ou par son emprise sur sa progéniture. Ce rôle se précise dans le récit dans son contrôle mnémonique et langagier, visant à assujettir sa fille et à l’empêcher de se subjectiver. En effet, la mère exerce avec insistance la mémoire de sa fille, ce qui oblige cette dernière à se souvenir, enracinant encore plus profondément la violence dans la psyché et le corps de la narratrice : « Papa fixé en elle papa fixé en moi à la tendre amnésie se dérober chaque jour application véreuse du dressage maternel[15] ». Ce dressage est exécuté en utilisant un jeu d’associations d’images et de mots, le Memory : « C’est un excellent exercice pour faire travailler ta mémoire disait la mère[16] ». La période de croissance et de formation de la narratrice est conditionnée à retenir son vécu par le langage et les images, et rend l’oubli impossible, oubli qui aurait pu offrir à l’enfant une possibilité de fuite, ou alors lui permettre, dans un processus bénéfique, de s’approprier ce que Gervais nomme « ces choses dont il faut se munir et se débarrasser pour progresser[17]». L’énonciation du récit indique bien comment la narratrice, en racontant son passé, a assimilé la violence vécue lors de l’enfance : « Pomme Château Valise Parapluie dis-moi que tu veux ta claque tout de suite[18]. » Ainsi, sa subjectivation est profondément affectée par le contrôle maternel de la mémoire et par la violence de son père. La mise en récit convoque les souvenirs, mais également les expressions de ses parents qui infiltrent les phrases, exprimant comment la mémoire traumatique s’inscrit à même le rapport au langage de la narratrice. Sidonie Smith, en se penchant sur le rôle de l’écriture autobiographique des femmes dans la création d’une identité textuelle chez ses autrices, remarque que cette identité est nécessairement affectée par l’influence parentale : « The autobiographer’s confrontation with those “maternal” and “paternal” narratives structures the narrative and dramatic texture of her self-representation and shapes her relationship to language, image and meaning[19]. » Si donc nous avons brièvement approché l’aspect autofictionnel de l’œuvre de Delaume, c’est justement en ce que la limite entre le rôle de la narratrice et celui de l’autrice est poreuse. Le cri du sablier est cet espace de l’énonciation de l’agent en quête de subjectivité. Il débute à même la mémoire imposée par ses parents, et qui sera déterminante pour la suite de son histoire, puisque « jamais elle ne pourrait javelliser ses souvenirs détacher à grande eau combien même lacrymale la rage et la fureur du père si trop puissant[20]. » L’impossibilité d’oublier est fondamentale dans l’entreprise du récit. Si la mémoire traumatique est imposée à la narratrice, c’est qu’elle cherchera, par l’entreprise d’une mise en récit de sa vie et de l’événement traumatisant, à l’exploiter, jusqu’à ce qu’elle puisse la poser comme objet en dehors d’elle.
À partir de ce matériau vif et douloureux qu’est la violence familiale et sa culmination dans la mise à mort de la mère et du suicide du père, l’établissement d’un récit subjectif devient un projet de remémoration par lequel se reconstruit le sujet traumatisé. Le texte autofictionnel fragmenté de Delaume configure cet espace de la mémoire en transformation. Le pacte de lecture qu’il présuppose est celui d’une forme de vérité du passé raconté tout en exploitant la liberté créative de la mise en récit fictionnelle. La mémoire nourrit le texte, et ce dernier, dans un second temps, rend compte de l’incarnation du trauma, de l’internalisation corporelle de la violence : « Le père revient bientôt déroulant derrière lui un tuyau d’arrosage. Le jet glacé abrupt violace lèvres et veinures la giclade [sic] déversée sur le sommet du crâne tentacules acérés pénétrant jusqu’aux tempes ça palpite en cristaux le sang se fige sinus moelle muqueuse chair et os […][21]. » Les détails de la violence, qu’ils soient rattachés à l’événement traumatique ou à la situation générale familiale, peuvent prendre la forme de métaphores vives et viscérales. L’intensité des agressions perpétrées par le père contre sa fille crée non seulement des images gravées dans la mémoire de sa progéniture, mais aussi dans celle du corps et du texte, qui participent à la reconstruction. Dans son essai Armer la rage, Marie-Pier Lafontaine explique comment l’écriture du trauma permet de se reconstituer un pouvoir, de redonner à une victime sa subjectivité : « Retraverser l’agression en pleine conscience et de manière lucide, en présence, permet de la rattacher au récit de soi, de l’assimiler pour finir par s’en délivrer[22] ».
Le corps du texte comme corps survivant : forme et subjectivité
En plus d’établir thématiquement l’impossibilité de l’oubli comme étant dynamique, le récit travaille cette tension à même sa forme. Le cri du sablier est composé d’une série de fragments parfois aussi courts que quelques phrases, alors que d’autres s’étirent sur plusieurs pages. Cette fragmentation inégale du récit reflète sa source, puisque la mémoire traumatique s’enregistre « de manière lacunaire et morcelée[23] ». Le texte suit une trajectoire qui n’est pas linéaire. Il s’ouvre quelques instants après le meurtre et le suicide du père, alors que la fillette doit faire face à l’après-coup, représenté par ses interactions avec des proches, des policiers et des psychologues. La temporalité du roman procède par analepses qui relatent la violence constante du père et la passivité de la mère, et par une narration au présent, dans laquelle la narratrice, à l’âge adulte, s’énonce et conjugue les répercussions de cette violence gravée dans son corps et sa psyché. Le fil de la mémoire traumatique relie et resserre ce récit d’une vie, dans une forme complexe et vive qui revendique l’agentivité de l’instance énonciative. La répétition est un autre procédé textuel qui prend racine dans les déclinaisons psychologiques de la mémoire traumatique. En réponse à l’événement, au choc, le traumatisme se déclenche et semble se répéter dans la conscience, comme l’affirme Cathy Caruth : « there is a response, sometimes delayed, to an overwhelming event or events, which takes the form of repeated, intrusive hallucinations, dreams, thoughts or behaviors […][24] ». Tout comme la temporalité du récit n’est pas une ligne continue, ce qui est raconté par la narration est décuplé, déconstruit et répété. Le traumatisme constitue un événement qui est omniprésent dans le récit, mais sa textualité renferme également cette mémoire circulaire. En effet, dans les premières pages, la narratrice rapporte les paroles qu’elle entend à la radio juste après le drame, alors que les policiers sont avec elle sur le lieu du crime : « L’espoir restait intact commenta la radio : nous avons eu un magnifique mois de juin[25] ». La fin de cette phrase s’immisce dans la scène charnière, dans cet instant qui a déclenché le traumatisme duquel le texte découle, et elle sera par la suite intégrée à neuf reprises à l’intérieur des fragments. La banalité et l’optimisme du commentaire sur le beau temps au moment où la fracture s’est opérée affecte profondément la mémoire du texte et celle de la narratrice. Cette dernière répètera la phrase dans différents contextes, même dans des scènes qui se sont déroulées avant l’événement : « on dit que les coups pleuvent et on doit s’étonner : le temps se couvre soudain pourtant nous avons eu un magnifique mois de juin[26] ». Le temps de la mémoire traumatique est désarticulé, cette fois dans un contexte de banalisation face à la violence du père. Selon Lafontaine, « le temps se replie sur lui-même alors que le souvenir se rejoue indéfiniment[27] »; de même, le roman de Delaume est marqué à vif par un oubli impossible. Ainsi, les scènes vécues qui sont imposées au sujet traumatisé composent la trame de son récit, mais c’est grâce à la mise en texte agitée et aux apparences confuses que la narratrice obtient une possibilité de prendre conscience de ce qui lui arrive et de ce qui l’habite. En effet, la répétition mène à la déformation de la phrase, à la désarticulation du récit : « On aurait dit que papa ne crierait plus jamais. […] Que maman viendrait me border en m’embrassant très fort. On aurait dit qu’on aurait eu un magnifique mois de juin[28] ». Une nouvelle scène s’invente dans le roman, où la violence cesserait et où la narratrice connaîtrait l’amour de sa mère. À cet effet, Kostas Nassikas constate que si, d’un côté, la « répétition semble aveugle et insensée[29] », elle permet néanmoins la « recherche de traduction de ces vécus insensés[30] ». Cette répétition, dans le roman de Delaume, crée également une échappatoire au récit de la mémoire imposée. Cette dernière est lacérée et travaillée avec acharnement par le texte, qui finit par laisser entrevoir de nouvelles versions du passé. La fiction permet à la mémoire traumatique de se teinter, d’être influencée, par une forme suggérée de l’oubli prise en charge par la fiction.
L’appropriation du récit écrit comme acte d’agentivité
L’écriture est une entreprise de parole, une affirmation du vécu. Pour Lafontaine, elle est à la fois un refus de laisser la violence tomber dans l’oubli et une manière de subvertir la mémoire traumatique : « La réinvention du trauma, par l’injection de fiction dans le matériau biographique, permet d’explorer le gouffre qui subsiste entre la vividité des actes de violence et l’irréalité qui enrobe leur souvenir[31] ». Cette transformation des souvenirs n’est pas un processus passif, mais bien un effort actif qui prend d’abord forme chez Delaume par une subversion du langage. Ce procédé tend à jouer avec des « inventions langagières, une syntaxe éclatée et la subversion des normes et conventions linguistiques[32] » en insérant des phrases asyntaxiques[33] ou en intégrant des dictons de manière à les dénaturer. Delaume écrira d’ailleurs : « L’oubli a ses raisons que la raison n’ignore[34] ». Ici, la phrase de Pascal est reprise et modifiée pour rappeler l’accès impossible à l’oubli. Ainsi, la narratrice subvertit les codes entourant la culture populaire et les procédés littéraires afin d’exprimer sa réalité. Les libertés créatrices permises par l’écriture se décuplent à mesure que progresse le récit. En effet, dans les premières pages, la narratrice mentionne que sa seule amie « s’appelait Cécile[35] », alors que plus loin, « sa seule amie s’appelait Mathilde[36] ». Ces changements dans l’histoire ne sont pas anodins, même s’ils s’apparentent à des manifestations de l’oubli. La narratrice nous rappelle que l’entreprise d’écriture autofictionnelle est en fait un acte de réécriture conscient, qui exploite l’ambiguïté : « Réécrire son histoire plumeau révisionnisme espérant malgré soi que la main paternelle stylet automatique se manifeste enfin pour implorer pardon en marges ou interlignes[37] ». La mémoire traumatique est le moteur de la main qui écrit et représente une tentative d’émancipation : elle cherche à rompre le lien qui l’unit au père. Le langage imposant de ce dernier, composé de coups, est confronté par les mots de sa fille. La voix de cette dernière affaiblit l’autorité absolue de la voix dominante. Deirdre Lashgari remarque d’ailleurs que « […] the constructive discourse of conflict becomes possible when polyvocal discourse interrupts the dominant monologue. The dialogic process is inherently confrontive, exposing discrepancies, contradictions, rifts[38] ». En effet, le récit, construit à partir d’une multiplicité textuelle grâce aux subversions narratives, déconstruit le discours dominant du père. La brèche ouverte par la fiction est due à l’écriture et à la réécriture, et les deux sont construites par cette mémoire traumatique omniprésente. Une des manifestations de la liberté que permet la fiction est une mise à mort du sujet – de la narratrice –, qui, bien que temporaire et réversible, a pour but d’extraire les traces de violence du père dont elle aurait hérité : « Le vieux soi opiniâtre n’aima pas trop mourir par un soir de février[39] ». En se faisant violence symboliquement, elle empêche la figure du père d’accomplir ce qu’il lui avait promis : « Un jour je vais te tuer[40]». La violence est refusée, réfutée, transformée par le langage. Cette émancipation du sujet par la mise en récit de l’événement, à partir de sa mémoire, culmine à la toute fin du roman. La narratrice se reconstruit en tant que sujet, pour ensuite commettre un acte d’ultime destruction : « Piquet et tête bêchée tes os s’effritent papa sous la pelle à grenaille. J’ai foutu le feu au jardin : cette année nous aurons un magnifique mois de juin[41] ». Des funérailles sans cérémonie, le personnage enterre et brûle l’espace symbolique où elle a enterré la mémoire de son père. La phrase répétée maintes fois au fil des fragments est à nouveau transformée, cette fois pour clore le texte. En écrivant le verbe avoir au futur simple, la narratrice pose le point final qui ouvre vers un avenir. Son contrôle du récit dépasse alors la mémoire traumatique, il lui « permet de faire bouger les scènes figées en [elle], de les décloisonner et, donc, de surmonter la répétition traumatique[42] ». Ce qu’accomplit alors la narratrice de Delaume s’inscrit en écho à ce qu’évoquait Roland Barthes en parlant du « dernier mot » : « Tout partenaire d’une scène rêve d’avoir le dernier mot. Parler en dernier, “conclure”, c’est donner un destin à tout ce qui s’est dit, c’est maîtriser, posséder […] ; dans l’espace de la parole, celui qui vient en dernier occupe une place souveraine […][43] ». La « scène du discours » entendu par Barthes est en fait une querelle, une passion forçant un discours, voire un combat entre deux amoureux. Cette intimité ne représente évidemment pas le cas de Delaume, puisqu’elle s’adresse à tout le monde – aux lecteurs, à elle-même et à son père –, mais évoque tout de même la clôture, le désir de triompher dont parle Barthes. Par l’écriture d’un roman, Delaume donne la parole à une narratrice qui peut finalement répondre à l’autre et le vaincre. En tant qu’unique survivante du massacre et de sa mise à mort symbolique opérée par l’écriture, elle seule peut avoir le dernier mot. Sa fiction violente la mémoire traumatique, elle achève le souvenir du père pour enfin « l’acculer au silence, le châtrer de toute parole[44] ». Si, comme l’avance Gervais, l’oubli peut être « un geste qui assure la progression[45] », la surexploitation de la mémoire traumatique par la mise en récit parvient également à le déjouer. La narratrice peut alors faire taire l’agresseur dans une violence émancipatrice, tout en légitimantses souffrances et sa parole. Au lieu de condamner le personnage, la mémoire est la source de son histoire, et sa maîtrise lui permet de vivre, d’aller de l’avant.
Conclusion
En prenant place dans le vécu de la victime, la violence ne crée pas l’oubli. La mémoire traumatique est fondatrice du récit de Delaume. Pour une victime, la violence peut être fondatrice de sa compréhension d’elle-même et de son vécu, mais, dans le cas de l’œuvre Le cri du sablier, il est impossible que « l’oubli et le silence en [soient] les dénominateurs communs[46] », puisque l’oubli est refusé à la narratrice, et ce, depuis l’enfance. Sa mère l’empêche d’oublier et travaille son rapport aux mots et au langage. Le silence, à la suite du drame, n’est pas un processus d’oubli actif, mais bien le temps de gestation d’une mémoire à raconter. L’enfant refuse le tabou que sa famille impose et l’entreprise de la parole se poursuit dans les pages du livre. La mise en récit montre également comment la mémoire traumatique s’impose au personnage, qui la rend publique – qui l’expose en dehors d’elle – par un travail du texte de répétition et de fragmentation. Le rapport à la mémoire traumatique est source de création, l’écriture qui en émerge permet de travailler la mémoire à son tour. En subvertissant le langage ainsi que sa propre histoire, et en exploitant les libertés de l’écriture, la narratrice se détruit pour détruire les traces du père en elle. La tension entre la mémoire et l’oubli prend forme par « la force brute du coup[47] » qui fait émerger la réinterprétation du récit de la narratrice traumatisée : « L’écriture du trauma incarne donc une pulsion d’avenir […][48] ». L’écriture permet de creuser les nuances d’une mémoire à la fois vive et ambigüe, posée sur des fondations à la fois vives et précaires, et c’est ainsi que la narratrice peut évoquer dans son propre récit un futur que la mémoire ou l’oubli n’auront pas encore saisi.
[1] Bertrand Gervais, La ligne brisée, Montréal, Le Quartanier, coll. « Erres Essai », 2008, p. 135.
[2] Ibid., p. 132.
[3] L’appartenance à ce genre littéraire n’est pas spécifiée, mais elle est fortement sous entendue : « C’est ainsi que la mère nomma Chloé la fille de l’aume […]. » Chloé Delaume, Le cri du sablier, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 28.
[4] Le père crée activement ce climat de violence (physique et psychologique), alors que la mère y participe implicitement, par sa complicité et son silence.
[5] Marie-Pier Lafontaine, Armer la rage : pour une littérature de combat, Montréal, Héliotrope, série « K », 2022, p. 14.
[6] Bertrand Gervais, op. cit., p. 144.
[7] Chloé Delaume, op. cit., p. 24.
[8] Kostas Nassikas, « Le trauma et le langage des sens », L’évolution psychiatrique, vol. 68, 2003, p. 201.
[9] Marie-Pier Lafontaine, Armer la rage : pour une littérature de combat, Montréal, Héliotrope, série « K », 2022, p. 14.
[10] Chloé Delaume, op. cit., p. 17.
[11] Ibid.
[12] Ibid., p. 15
[13] Kostas Nassikas, op. cit., p. 207.
[14] Ibid., p. 18
[15] Chloé Delaume, op. cit., p. 66.
[16] Chloé Delaume, op. cit.,p. 64.
[17] Bertrand Gervais, La ligne brisée, op. cit., p. 57.
[18] Ibid., p. 65.
[19] Sidonie Smith, A Poetics of Women’s Autobiography : Marginality and the Fictions of Self-Representation, Bloomington, Indiana University Press, 1987, p. 51. « La confrontation de l’autobiographe avec les structures narratives “maternelles” et “paternelles” structure la texture narrative et dramatique de sa représentation d’elle-même, et forge aussi sa relation avec le langage, les images, et le sens. » (Ma traduction).
[20] Chloé Delaume, op. cit., p. 65.
[21] Ibid., p. 41.
[22] Marie-Pier Lafontaire, op. cit., p. 58-59.
[23] Ibid., p. 14.
[24] Cathy Caruth, Trauma : Explorations in Memory, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, p. 4. « La réponse, parfois décalée, à un événements ou à une suite d’événements accablants peut prendre la forme d’hallucinations, de rêves, d’idées ou d’attitudes répétées. » (Ma traduction).
[25] Chloé Delaume, op. cit., p. 11.
[26] Ibid., p. 21.
[27] Marie-Pier Lafontaine, op. cit., p. 15.
[28] Chloé Delaume, op. cit., p. 58.
[29] Kostas Nassikas, op. cit., p. 209.
[30] Ibid.
[31] Marie-Pier Lafontaine, op. cit., p. 63.
[32] Michèle Gaudreau, « Violence et identité dans Les mouflettes d’Atropos et Le cri du sablier de Chloé Delaume », Les Cahiers de L’IREF, coll. « Tremplin », n°2, 2011, p. 53.
[33] « Sur sa joue gauche l’enfant reçu fragment cervelle », Chloé Delaume, op. cit., p. 19.
[34] Ibid., p. 112.
[35] Chloé Delaume, op. cit., p. 15.
[36] Ibid., p. 93.
[37] Ibid., p. 80.
[38] Deirdre Lashgari, Violence, Silence, and Anger : Women’s Writing as Transgression, Charlottesville, University Press of Virginia, 1995, p. 3. « La construction d’un discours de conflit devient possible quand le discours polyphonique interrompt le monologue dominant. Le processus dialogique est intrinsèquement confrontant puisqu’il expose les disparités, les contradictions, les ruptures. » (Ma traduction)
[39] Chloé Delaume, op. cit., p. 112.
[40] Ibid., p. 50.
[41] Ibid., p. 127.
[42] Marie-Pier Lafontaine, op. cit., p. 63-64.
[43] Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, p. 247. L’auteur souligne.
[44] Ibid.
[45] Bertrand Gervais, La ligne brisée, op. cit., p. 57.
[46] Ibid., p. 131.
[47] Bertrand Gervais, La ligne brisée, op. cit., p. 132.
[48] Marie-Pier Lafontaine, op. cit., p. 69.
Bibliographie
Barthes, Roland, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, 280 p.
Caruth, Cathy (dir.), Trauma : explorations in memory, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 277 p.
Delaume, Chloé, Le cri du sablier, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001, 127 p.
Gaudreau, Michèle, « Violence et identité dans Les mouflettes d’Atropos et Le cri du sablier de Chloé Delaume », Les Cahiers de L’IREF, coll. « Tremplin », n°2, 2011, 84 p.
Gervais, Bertrand, La ligne brisée, Montréal, Le Quartanier, coll. « Erres Essai », 2008, 216 p.
Lafontaine, Marie-Pier, Armer la rage : pour une littérature de combat, Montréal, Héliotrope, série « K », 2022, 111 p.
Lashgari, Deirdre (dir.), Violence, silence, and anger : women’s writing as transgression, Charlottesville, University Press of Virginia, 1995, 351 p.
Nassikas, Kostas, « Le trauma et le langage des sens », L’évolution psychiatrique, vol. 68, 2003, p. 199-209, en ligne, < DOI: 10.1016/S0014-3855(03)00022-7 >, consulté le 2 avril 2022. Smith, Sidonie, A poetics on women’s autobiography: marginality and the fictions of self-representation, Bloomington, Indiana University Press, 1987, 211 p.