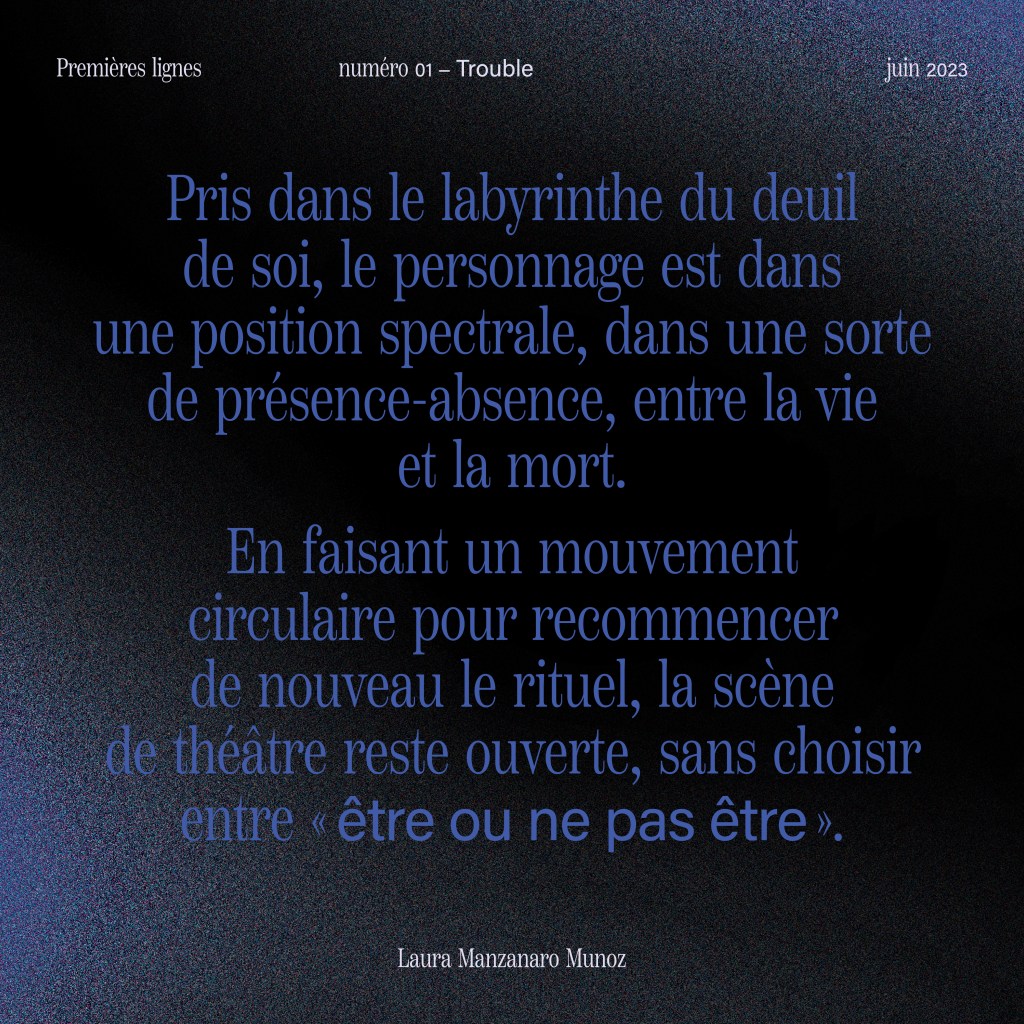Immergé dans un récit labyrinthique, le personnage de 4.48 Psychose se dirige vers sa mort tout en la retardant par la prise de la parole. Désir de disparaître, d’échapper au corps-minotaure, mais à la fois refus de mourir sans se prononcer une dernière fois, le texte tisse une véritable spirale vers la perte de soi. 4.48 Psychose est la dernière des cinq pièces de théâtre de l’autrice anglaise Sarah Kane (1971-1999). Si ses œuvres s’inscrivent, au début de sa carrière, dans le In-yer-face theater[1], un courant des années quatre-vingt-dix qui fonctionne « par choc visuel », cette pièce appartient à un moment postérieur de son écriture, plus proche, dans les mots d’Élisabeth Angel-Perez, d’un théâtre poétique[2].
Le texte, entre poème et théâtre, sans didascalies ou indications de personnages, présente une série de fragments énoncés par une voix, ou plusieurs voix, non identifiées. Dans un récit qui peut être qualifié de « fiction de la dissolution », un « je » annonce son suicide imminent qui aura lieu à 4h48. Listes de symptômes, de médicaments ou rencontres chez le psychiatre s’entremêlent avec des passages plus poétiques dans lesquels la parole du personnage se débat entre l’obscurité et la lumière, entre le désir de mourir et celui de vivre. Nous analyserons la pièce en la rapprochant de la notion de labyrinthe, évoquée par Bertrand Gervais comme « lieu imaginaire d’une épreuve[3] » qui « symbolise l’oubli de soi, la perte de ses repères et ultimement la mort[4] ». En effet, 4.48 Psychose met en récit une lutte tragique qui mène à la dissolution, une tension au sein de l’individu qui parle, qui oscille entre la vie et la mort, la mémoire et l’oubli. À travers toute une série de configurations paradoxales qui produisent un tiraillement dans l’énonciation, nous verrons comment la pièce peut être lue en tant que labyrinthe de la perte de soi, où le personnage qui énonce va irréversiblement vers la mort, en la désirant et la refusant à la fois.
Dans un premier temps, nous traiterons du statut problématique de la parole mise en jeu par le texte se manifestant par l’indétermination de la voix énonciatrice, l’absence de lien avec l’Autre et le paradoxe de parler pour disparaître. Dans un deuxième temps, l’analyse portera sur la place du corps, présenté comme lieu de souffrance, d’enfermement et de dysphorie. Finalement, le travail s’arrêtera sur la mort en tant que sortie du labyrinthe du texte, pouvant être lue comme un sacrifice, un acte rituel par lequel la mémoire peut faire place à l’oubli.
LA PAROLE BRISÉE
La pièce présente une parole qui peut être qualifiée de labyrinthique dans le sens où elle est multiple, indécidable, contradictoire. Ce que Sarah Kane avait entrepris dans Manque, où les entités d’énonciation sont désignées uniquement par des lettres, est poussé dans 4.48 Psychose jusqu’au point de ne pas pouvoir saisir le lieu d’où surgit la parole. Sans aucune indication de personnage, nous sommes dans l’impossibilité de répondre à la question qui parle, impossibilité qui rend l’énonciation fragile, mouvante. Qui est ce « je »? S’agit-il d’une seule voix ou de plusieurs entités?
La forme du texte participe à cette indécidabilité, puisqu’au lieu de présenter des scènes, la pièce est constituée d’une série de fragments. Passages poétiques, dialogues, énumérations et suites de mots et de chiffres composent une œuvre hybride et multiple où le « je » apparaît et disparaît pour se faire « avaler » à la fin du texte par l’espace blanc de la page. Les fragments se succèdent, créant une fable fuyante, liés seulement par un fil conducteur, celui du désir de mort, un désir qui est cependant porté par l’énonciation de manière contradictoire, mettant à mal l’identité du personnage :
Je ne veux pas mourir
Je me suis trouvée si déprimée par le fait d’être mortelle que j’ai décidé de me suicider
Je ne veux pas vivre[5].
Le texte tourne autour de cette « mort hypo-volontaire » (p. 34), plaçant « je » dans une structure labyrinthique où il se constitue à la fois comme centre et comme frontière. Le « 4.48 » du titre apparaît comme le point de fuite vers lequel tout tend, un espace-temps qui est la mort, dont le « je » ne peut cesser d’évoquer son désir contradictoire : « [j]e n’ai aucun désir de mort / aucun suicidé n’en a » (p. 54).
Le conflit a lieu aussi au sein de l’énonciation même, puisqu’en même temps que l’entité énonciatrice annonce sa mort, elle manifeste une volonté d’exister par la prise de parole. La pièce tourne autour d’un centre, d’un trou noir qui est la mort du « je », mais cette mort est décalée constamment par le texte, produisant un effet d’attente, d’une immersion dans un labyrinthe à la fois spatial et temporel. Dans le cheminement labyrinthique, vers la fin, les mots dirigent le sujet vers ce point central, pour l’éloigner en même temps de celui-ci :
À 4.48
quand le désespoir fera sa visite
je me pendrai
au son du souffle de mon amour (p. 12)
Le mouvement créé par les fragments peut être vu comme une spirale : le « je » s’approche et s’éloigne, connaissant d’avance sa dissolution finale, mais refusant de disparaître sans parler : « Je vais mourir / pas encore / mais c’est là » (p. 34). Si la dissolution était l’oubli, la prise de parole laisse pourtant une trace, une mémoire, portée par l’acte de mise en récit.
Le texte donne ainsi à la parole une place centrale, puisque c’est le langage qui tient le sujet en vie. Comme le remarque Élisabeth Angel-Perez, Sarah Kane n’est pas du côté du théâtre absurde, où le langage n’a plus de sens :
Chez Kane, les mots, même réduits, même en déliquescence, sont là pour dire. On se rappelle ce que les maîtres de l’absurdisme – Ionesco, Becket, Adamov – ont pu écrire sur l’impossibilité du mot à « parler » […]. Au contraire, chez Kane, […] le mot – adoré ou haï – ne parle jamais pour ne rien dire[6]
En effet, dans 4.48 Psychose, nous sommes devant des mots qui sont le sujet, qui disent le sujet. Même devant la mort imminente, le langage permet de dire une vérité, de performer : « Rien qu’un mot sur une page et le théâtre est là » (p. 19). Dans Manque, sa pièce précédente, Sarah Kane mettait déjà en scène un rapport similaire au langage : « Je hais ces mots qui me gardent en vie, je hais ces mots qui m’empêchent de mourir[7] ». La dissolution du personnage devient d’autant plus « efficace » que sa parole agit.
Une des questions qui revient dans le texte est celle du rapport à l’Autre. Dans l’impossibilité de se faire entendre et d’établir un contact avec les autres, le sujet ne peut pas sortir de soi, de sa souffrance : « je n’arrive pas à vous trouver » (p. 21). La division à l’intérieur de soi est ainsi doublée d’une division entre le « je » et l’Autre, qui est à son tour source de contradiction : « Je ne peux pas rester seule / Je ne peux pas rester avec les autres » (p. 11). Se balançant entre la vie et la mort, le personnage peut seulement sortir de la spirale de violence, du labyrinthe, par la présence de l’Autre, mais le fil est brisé et, comme l’affirme Bertrand Gervais, « [s]ans Ariane, le labyrinthe est un tombeau[8] ». Le texte fait apparaître souvent le silence, ouvrant un grand vide devant le « je ». Nous pouvons observer ceci dès le début de la pièce, où l’absence de réponse est particulièrement significative :
Un très long silence.
– Mais vous avez des amis.
Un long silence.
Vous avez beaucoup d’amis.
Qu’offrez-vous à vos amis pour qu’ils soient un tel appui?
Un long silence.
Qu’offrez-vous à vos amis pour qu’ils soient un tel appui?
Un long silence.
Qu’offrez-vous?
Silence. (p. 9)
LE CORPS EN MINOTAURE
Le texte reprend une dualité traditionnellement portée par la philosophie cartésienne, celle qui postule la division entre le corps et l’esprit. Le motif revient à plusieurs reprises dans la pièce, toujours pour insister sur l’incapacité du personnage à intégrer dans l’expérience subjective un discours imposé par l’autre : « Et je suis acculée par la douce voix psychiatrique de la raison qui me dit qu’il y a une réalité objective où mon corps et mon esprit ne sont qu’un. Mais je n’y suis pas et n’y ai jamais été » (p. 14).
Cette division angoissante provoque un sentiment de répulsion et d’aliénation à l’égard du corps qui apparaît, tout au long du texte, comme étranger à soi : « Vous croyez qu’il est possible de naitre dans le mauvais corps? » (p. 21). Dans l’expérience corporelle du personnage, qui se définit dans un passage comme « hermaphrodite brisé » (p. 10), rien ne coïncide avec l’esprit, tout ramène à un dégoût envers son propre corps : « [j]e suis grosse » (p. 11), « [m]es hanches sont trop fortes / J’ai horreur de mes organes génitaux » (p. 12). La non-coïncidence est vécue par le sujet du texte comme une coupure douloureuse et impossible à dépasser :
Le corps et l’âme ne peuvent jamais être mariés
J’ai besoin de devenir ce que je suis déjà et gueulerai à jamais contre cette incongruité qui m’a vouée à l’enfer
Un insoluble espoir ne peut me soutenir
Je me noiera dans la dysphorie
dans la froide mare noire de mon moi
le puits de mon esprit matériel (p. 18)
La souffrance qui découle de la rupture radicale éprouvée par le personnage est mise en scène de manière particulièrement significative dans ce passage. Nommée par des expressions telles qu’« incongruité », « dysphorie » ou « puits », la division corps/esprit apparaît comme une fatalité « infernale ». Elle est présentée comme la cause de sa douleur et, comme ce qui la mènera à la mort, la « noiera » dans la matérialité de la chair. En même temps, cette mort serait nécessaire pour libérer l’âme du corps : mourir lui permettrait de « devenir ce qu’elle est déjà », de résoudre la coupure souffrante : « Je me sens comme si j’avais quatre-vingts ans. Je suis fatiguée de la vie et mon esprit veut mourir » (p. 16). En ce sens, nous pouvons rapprocher le corps de la figure du minotaure : monstrueux, hostile, il faudrait le tuer pour sortir du labyrinthe dans lequel le personnage se trouve enfermé. Ainsi, la mort vers laquelle tend le personnage depuis le début du texte serait une manière de se libérer de la prison de la chair devenue labyrinthique. Mourir, pour sortir de « ce monstrueux état de paralysie » (p. 30) qui vient de l’incongruité entre support charnel et âme.
La pièce se tisse, dès le début, comme un récit en dédale ayant pour objet le deuil de soi, un soi, comme nous venons de voir, divisé : « Je suis arrivée à la fin de cette effrayante répugnante histoire d’une conscience internée dans une carcasse étrangère » (p. 19). Il s’agirait d’un travail d’oubli, puisque le personnage va vers la disparition, la mort, dans lequel le corps serait un « trop de mémoire » que l’esprit ne peut porter.
D’ailleurs, le texte présente un imaginaire de la lumière qui apparaît comme venant d’en haut. En opposition au lexique de l’ombre, du « puits » qui représente le corps, qui mène le sujet vers le bas, nous trouvons plusieurs occurrences du couplet « Ouverture de la trappe / lumière crue » (p. 33, 38, 49). Celles-ci peuvent être mises en relation avec un plan vertical, qui serait une sortie possible du labyrinthe : si le « je » se trouve enfermé dans une sorte de prison sur le plan horizontal, soit celle du corps matériel, l’esprit immatériel sortirait de l’enfermement sur un plan vertical. Il s’agirait d’une possibilité de transcender le réel charnel, de tuer ce minotaure qui est le corps, ce monstre qui « ne coïncide pas » avec l’esprit.
LE THÉÂTRE COMME RITUEL DE SACRIFICE
Le récit labyrinthique de 4.48 Psychose, pivotant autour de la violence contre soi, peut être lu en tant que structure sacrificielle. En ce sens, la dernière phrase du texte, « s’il vous plaît, levez le rideau » (p. 56), indique une fin qui revient au début, une configuration circulaire qui se retourne sur elle-même. En tant que configuration rituelle, le dispositif scénique recommencerait et ce corps érigé en minotaure serait sacrifié à l’infini sur la scène de théâtre.
L’ambivalence portée par le texte, dans ses rapports paradoxaux entre vie et mort, le rapproche du rituel sacré : « peut-être ça va me sauver / peut-être ça va me tuer » (p. 35). La pièce se constitue ainsi comme un cadre qui permet de transformer le négatif en positif, de renouveler le lien social en transformant la vie en mort, la mort en vie. En effet, la violence qui a lieu à l’intérieur de l’espace rituel devient sacrée et permet une sorte d’oubli par le sacrifice. De la même manière, la structure créée sur la scène théâtrale de 4.48 Psychose permettrait d’échapper à la violence, en représentant le corps à la fois comme minotaure, à la fois comme Thésée le pourfendant.
Un des fragments de la pièce permet de voir le lien entre le collectif et l’individuel, caractéristique essentielle du rituel sacré :
J’ai gazé les Juifs, j’ai tué les Kurdes, j’ai bombardé les Arabes, j’ai baisé des petits enfants qui demandaient grâce, les champs qui tuent sont à moi, tout le monde a quitté la fête à cause de moi, je vais gober tes putains d’yeux et les envoyer à ta mère dans une boîte et quand je mourrai je vais me réincarner […] (p. 35)
La violence collective vient ici se concentrer sur l’individu, qui absorbe les pires crimes de l’humanité dans son corps. Avec le sacrifice d’une seule victime, le « je » du texte, il y aurait une rédemption de ces crimes, qui pourront être « lavés » par une seule mort. Dans les mots de René Girard, « [c]’est la communauté entière que le sacrifice protège de sa propre violence, c’est la communauté entière qu’il détourne vers des victimes extérieures[9] ». Le personnage de 4.48 Psychose s’érige ainsi en tant que phármakon, dont « l’innocence » est rappelée à répétition dans plusieurs passages du texte : « Ce n’est pas votre faute » (p. 17, 24, 27, 48). Nous trouvons aussi un lien entre la mort rédemptrice et le renouvellement qui vient par la réincarnation (« et quand je mourrais je vais me réincarner » (p. 35)), trait christique qui est amené dans d’autres moments du texte, notamment lors d’un passage où le personnage semble en transe mystique : « Pourquoi suis-je frappée? / J’ai eu des visions de Dieu / et cela adviendra » (p. 36). La dimension divine du « je » passe aussi par la parole performative, un autre aspect qui rapproche le texte du rituel sacré. Comme nous avons vu, la pièce met en scène comment les mots portent une vérité sur le sujet qui parle en amenant le personnage à exister et à se dissoudre avec la même intensité paradoxale: « [r]ien qu’un mot sur une page et le théâtre est là » (p. 19). Le dernier fragment du texte rend ainsi effective la dissolution, en la rapprochant du rituel par la dimension collective de la scène :
regardez-moi disparaître
regardez-moi
disparaître
regardez-moi
regardez-moi
regardez (p. 55)
CONCLUSION
Nous avons vu comment rapprocher 4.48 Psychose de la notion de labyrinthe permet de réfléchir aux configurations entre parole, corps et sacrifice. La spécificité du cadre d’énonciation, qui présente un « je » décomposé et multiple, montre comment « [c]e ne sont pas les murs ou les artifices qui créent le labyrinthe, c’est la perte de soi[10] ». Sarah Kane réécrit la tragédie classique pour mettre en récit un désir de mort qui, loin d’être individuel, relève du collectif. Dans ce même sens, la division entre corps et esprit devient dans la pièce une forme d’aliénation, de dégoût de soi, dont le sujet ne peut échapper que par le suicide. Et celui-ci, par la composante de violence qu’il permet d’évacuer, se transforme par l’écriture en rituel de sacrifice dont le « je » serait victime et bourreau.
Pris dans le labyrinthe du deuil de soi, le personnage est dans une position spectrale, dans une sorte de présence-absence, entre la vie et la mort. En faisant un mouvement circulaire pour recommencer de nouveau le rituel, la scène de théâtre reste ouverte, sans choisir entre « être ou ne pas être ».
[1] Alek Sierz, In-yer-face theatre: British drama today, Londres,Faber and Faber, 2001.
[2] Élisabeth Angel-Perez, Voyages au bout du possible : Les théâtres du traumatisme, de Samuel Beckett à Sarah Kane, Paris, Klincksieck, coll. « Angle ouvert », 2006, p. 153.
[3] Bertrand Gervais, Logiques de l’imaginaire, tome 2. La ligne brisée: labyrinthe, oubli et violence, Montréal, Le Quartanier, 2008, p. 14.
[4] Bertrand Gervais, « L’effacement radical: Maurice Blanchot et les labyrinthes de l’oubli », Protée, vol. 30, nº 3, 2002, p. 66.
[5] Sarah Kane, 4.48 Psychose, Paris, L’Arche, 2001, p. 12. Désormais, les références à cet ouvrage seront placées entre parenthèses dans le texte.
[6] Élisabeth Angel-Perez, Voyages au bout du possible : Les théâtres du traumatisme, de Samuel Beckett à Sarah Kane, op. cit., 2006, p. 175.
[7] Sarah Kane, Manque, Paris, L’Arche, p. 50, cité dans Élisabeth Angel-Perez, Voyages au bout du possible : Les théâtres du traumatisme, de Samuel Beckett à Sarah Kane, op. cit., p. 175.
[8] Bertrand, Gervais, Logiques de l’imaginaire, tome 2. La ligne brisée : labyrinthe, oubli et violence, op. cit., p. 92.
[9] René Girard, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972, p. 22.
[10] Bertrand Gervais, « L’effacement radical: Maurice Blanchot et les labyrinthes de l’oubli », loc. cit., p. 66.
BIBLIOGRAPHIE
Angel-Perez, Élisabeth, Voyages au bout du possible: Les théâtres du traumatisme, de Samuel Beckett à Sarah Kane, Paris, Klincksieck, coll. « Angle ouvert », 2006, 229 p.
Gervais, Bertrand, Logiques de l’imaginaire, tome 2. La ligne brisée: labyrinthe, oubli et violence, Montréal, Le Quartanier, 2008, 207 p.
Gervais, Bertrand, « L’effacement radical: Maurice Blanchot et les labyrinthes de l’oubli », Protée, vol. 30, nº 3, 2002, p. 63–72.
Girard, René, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972, 451 p.
Kane, Sarah, 4.48 Psychose, Paris, L’Arche, 2001, 56 p. Sierz, Alek, In-yer-face theatre: British drama today, Londres, Faber and Faber, 2001, 288 p.